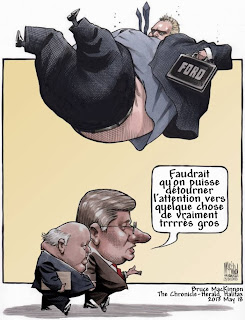POURQUOI STEPHEN HARPER RISQUE DE PASSER POUR LE PLUS GRAND PREMIER MINISTRE DU CANADA DU XXIe SIÈCLE
Ce texte contient des scènes politiques,
de nudité et de sexe qui pourraient ne pas
convenir à tous les lecteurs. La S.R.C.
préfère vous en avertir. C’est terrible avoir à penser cela. Les politiques de Harper sont méprisables au plus haut point et nous devrions en avoir moralement et intellectuellement une honte des plus blessantes : la démagogie partisane, l’effronterie internationale, le mépris des peuples, l’impérialisme nordique, le militarisme effréné, le nationalisme borné, l’anti-intellectualisme primaire, et sans doute que chacun d’entre vous y ajouterait sa pierre personnelle. Si Stephen Harper était la femme adultère de la parabole, personne ne se retiendrait de lui lancer sa pierre.
Nous regardons ainsi le «règne» de Stephen Harper car nous payons, par notre travail, nos taxes, nos impôts et les compressions budgétaires imposées, le prix de ses politiques démentes. Nous ne pouvons avoir sous les yeux la dimension des temps à venir qui replaceront dans une perspective logique cette débauche de politiques asociales.
 Reportons-nous un peu plus d’un siècle en arrière. Un Bismarck aurait pu recevoir autant de pierres de la part des Allemands de son époque, toutes classes confondues, que notre Harper; mais, à travers son empressement à donner des politiques de sécurité sociale aux Allemands, il coupait l'herbe sous le pied de ses adversaires socialistes, de même que par sa diplomatie militaire de n’ouvrir qu’un seul front à la fois, il donnait une sage défensive à laquelle le Troisième Reich de Hitler a pu s’imposer pendant deux ans à l’ensemble de l’Europe. Rompant avec la politique bismarckienne, il signait l’arrêt de mort de son régime - et le sien. Voilà pourquoi, aux yeux du XXe siècle, Bismarck fut un grand chancelier et un homme d’État occidental incomparable. Dans un siècle, il est probable que nous dirons la même chose de Stephen Harper et, eh oui, c’est tout aussi affligeant.
Reportons-nous un peu plus d’un siècle en arrière. Un Bismarck aurait pu recevoir autant de pierres de la part des Allemands de son époque, toutes classes confondues, que notre Harper; mais, à travers son empressement à donner des politiques de sécurité sociale aux Allemands, il coupait l'herbe sous le pied de ses adversaires socialistes, de même que par sa diplomatie militaire de n’ouvrir qu’un seul front à la fois, il donnait une sage défensive à laquelle le Troisième Reich de Hitler a pu s’imposer pendant deux ans à l’ensemble de l’Europe. Rompant avec la politique bismarckienne, il signait l’arrêt de mort de son régime - et le sien. Voilà pourquoi, aux yeux du XXe siècle, Bismarck fut un grand chancelier et un homme d’État occidental incomparable. Dans un siècle, il est probable que nous dirons la même chose de Stephen Harper et, eh oui, c’est tout aussi affligeant. Malgré les vains efforts de Yann Martel - l’auteur du Livre de Pi - d’initier notre Premier ministre du Canada à la grande littérature, on peut se demander, à part des cahiers à colorier, quel livre cet esprit a bien pu lire par le passé? Ne rions pas. Harper a parfaitement assimilé le Machiavel pour les nuls. Il a retenu chacune des leçons du Prince avec une parfaite amoralité devant la prise et la conservation du pouvoir. Nous ne l’aimons pas? Ça ne l’affecte nullement, tant il sait que la crainte est meilleure garantie que l’affection. Nous le trouvons opportuniste? Tant mieux, il servira les intérêts de ses bailleurs de fonds avec moins de circonspection. Il tient ses amis proches mais ses ennemis encore plus proches? Cela lui a évité bien des dérapages. Contre les trudeaumanes et coupant l'herbe sous le pied du Bloc Québécois, il a octroyé la reconnaissance de la nation québécoise sans que cela ne lui coûte aucune application réelle de cette reconnaissance. Nous le trouvons caché sous le jupon de la reine, et c’est la Banque d’Angleterre qui vient débaucher le président de la Banque du Canada pour redresser ses finances. Sont-ce là de ces ruses de la raison que Hegel voyait parfois s’immiscer dans la dynamique de l’Histoire?
Malgré les vains efforts de Yann Martel - l’auteur du Livre de Pi - d’initier notre Premier ministre du Canada à la grande littérature, on peut se demander, à part des cahiers à colorier, quel livre cet esprit a bien pu lire par le passé? Ne rions pas. Harper a parfaitement assimilé le Machiavel pour les nuls. Il a retenu chacune des leçons du Prince avec une parfaite amoralité devant la prise et la conservation du pouvoir. Nous ne l’aimons pas? Ça ne l’affecte nullement, tant il sait que la crainte est meilleure garantie que l’affection. Nous le trouvons opportuniste? Tant mieux, il servira les intérêts de ses bailleurs de fonds avec moins de circonspection. Il tient ses amis proches mais ses ennemis encore plus proches? Cela lui a évité bien des dérapages. Contre les trudeaumanes et coupant l'herbe sous le pied du Bloc Québécois, il a octroyé la reconnaissance de la nation québécoise sans que cela ne lui coûte aucune application réelle de cette reconnaissance. Nous le trouvons caché sous le jupon de la reine, et c’est la Banque d’Angleterre qui vient débaucher le président de la Banque du Canada pour redresser ses finances. Sont-ce là de ces ruses de la raison que Hegel voyait parfois s’immiscer dans la dynamique de l’Histoire?La conséquence du machiavélisme appliqué consiste essentiellement à hisser le Prince au-dessus des lois, ce qui dans le temps avait appelé la réplique légaliste de Jean Bodin. Les résultats deviennent la mesure morale des moyens utilisés, ce qui a entraîné la répulsion des vertueux habitants des sépulcres blanchis. Le principe de réalité qui impose
 le pouvoir, le commandement, la direction, a pour effet la castration, l’impuissance et la soumission et, malgré nos cris de protestations, personne ne se lève pour appeler à abattre le tyran. L’opposition s’auto-muselle avec des chefs politiques qui n’ont ni une vision utopique ni l’enthousiasme du combattant qui résisterait à une tyrannie. On ose même pas utiliser le mot ni le ton tant notre conception dévirilisée de la démocratie bloque ce mot dans le fond de notre gorge. Le libéral-démocrate Thomas Mulcair - Tom, car s’il y a Tom au Parlement il n’y a pas Steve en face de lui -, Tom Mulcair donc, n’est qu’un bon batailleur mais pas un condottieri capable de foudroyer le dragon. Tant qu’à Mini-Pet, laissons-le avec sa mini-buste. La tête enflée grosse comme les seins de sa femme ne mérite pas qu’on s’y arrête un instant de peur de prendre une vessie pour une lanterne.
le pouvoir, le commandement, la direction, a pour effet la castration, l’impuissance et la soumission et, malgré nos cris de protestations, personne ne se lève pour appeler à abattre le tyran. L’opposition s’auto-muselle avec des chefs politiques qui n’ont ni une vision utopique ni l’enthousiasme du combattant qui résisterait à une tyrannie. On ose même pas utiliser le mot ni le ton tant notre conception dévirilisée de la démocratie bloque ce mot dans le fond de notre gorge. Le libéral-démocrate Thomas Mulcair - Tom, car s’il y a Tom au Parlement il n’y a pas Steve en face de lui -, Tom Mulcair donc, n’est qu’un bon batailleur mais pas un condottieri capable de foudroyer le dragon. Tant qu’à Mini-Pet, laissons-le avec sa mini-buste. La tête enflée grosse comme les seins de sa femme ne mérite pas qu’on s’y arrête un instant de peur de prendre une vessie pour une lanterne.Contrairement à ses adversaires politiques, Stephen Harper a une vision du Canada, une vision qu’il est prêt à imposer contre le monde entier, comme nous l’avons constaté dès le temps où il dirigeait un gouvernement minoritaire et qu’il a versé son pétrole des sables bitumineux albertains
 dans le carburateur de Kyoto. Contre le monde entier - et surtout l’Europe -, il s’est mis au défi d’avoir raison jusqu’à envoyer son ministre des ressources naturelles oser dire face à la communauté européenne que le pétrole des sables bitumineux était une source d’énergie écologique! Machiavel aurait apprécié une telle gifle. Et, contrairement à il y a cinq ou six ans, les Européens ont avalé la pierre sans gourmander! Il se peut que les Européens commencent à entrevoir ce qu’a été, depuis toujours, le plan Harper. Et ne parlons surtout pas d’agenda caché, car tout est là, sous nos yeux, comme la Lettre volée d’Edgar Poe. C’est nous qui nous refusons obstinément de voir, car la peur de percer «le monde selon Harper» nous effraie tant elle pourrait nous séduire. Pourtant, c’est bien cette vision d'une poétique de l'avenir du Canada qui l’inspire dans ses décisions.
dans le carburateur de Kyoto. Contre le monde entier - et surtout l’Europe -, il s’est mis au défi d’avoir raison jusqu’à envoyer son ministre des ressources naturelles oser dire face à la communauté européenne que le pétrole des sables bitumineux était une source d’énergie écologique! Machiavel aurait apprécié une telle gifle. Et, contrairement à il y a cinq ou six ans, les Européens ont avalé la pierre sans gourmander! Il se peut que les Européens commencent à entrevoir ce qu’a été, depuis toujours, le plan Harper. Et ne parlons surtout pas d’agenda caché, car tout est là, sous nos yeux, comme la Lettre volée d’Edgar Poe. C’est nous qui nous refusons obstinément de voir, car la peur de percer «le monde selon Harper» nous effraie tant elle pourrait nous séduire. Pourtant, c’est bien cette vision d'une poétique de l'avenir du Canada qui l’inspire dans ses décisions.1. La démagogie partisane
Nous avons parlé de la démagogie partisane qu’utilisait Harper dans ses discours et sa rhétorique pour vendre ses projets de loi. Harper est un tyran. Nous associons immédiatement la négativité au mot de sorte qu’il apparaît redondant de dire que Harper est un «tyran mauvais». Mais certains conservateurs trouvent sans doute que Harper est
 un bon tyran. Parce qu’il promeut leurs intérêts, mais aussi parce qu’il obéit à une tradition politique canadienne qu’on a vu à maintes reprises se répéter par le passé. J’ignore si Harper est ou non un grand lecteur, mais il a probablement lu le Duplessis de Conrad Black. Le baron de la presse conservatrice - un temps noble siégeant à la Chambre des Lords, un temps prisonnier dans les cachots américains -, avait écrit cette lourde biographie (mal-faite) du Premier ministre du Québec Maurice Duplessis (1936-1959). La démagogie avec laquelle Duplessis méprisait ses adversaires libéraux T.-D. Bouchard et G.-É. Lapalme; l’utilisation qu’il faisait du terrorisme de la Guerre Froide pour saisir - la célèbre loi du cadenas - les pamphlets de gauche; l’utilisation également qu’il faisait de la Police Provinciale pour matraquer les syndiqués; la manipulation idéologique du clergé catholique, le duplessisme était une politique démagogique de droite où l’autoritarisme se moquait du processus démocratique grâce à la corruption et au trafic des scrutins. Les récents scandales qui ont éclaboussé le gouvernement conservateur entraînés par des sénateurs rapaces et des conseillers maladroits ont, pour les Québécois, un air de déjà-vu. Mais Harper a hérité un autre aspect de la démagogie de Duplessis. Il ne se met pas lui-même en cause. Alors que l’Union Nationale, le parti politique de Duplessis, a rempli ses coffres et ceux de l'État avec la «petite loterie» des corrompus, Duplessis est mort plutôt pauvre. C’est avec l’argent de la corruption de l’Union Nationale que les Libéraux de Jean Lesage et de son «équipe du tonnerre» nous ont payé la Révolution tranquille de 1960. Harper et Duplessis, chacun à leur façon, font passer les intérêts de leur clientèle respective avant la satisfaction de leurs biens personnels.
un bon tyran. Parce qu’il promeut leurs intérêts, mais aussi parce qu’il obéit à une tradition politique canadienne qu’on a vu à maintes reprises se répéter par le passé. J’ignore si Harper est ou non un grand lecteur, mais il a probablement lu le Duplessis de Conrad Black. Le baron de la presse conservatrice - un temps noble siégeant à la Chambre des Lords, un temps prisonnier dans les cachots américains -, avait écrit cette lourde biographie (mal-faite) du Premier ministre du Québec Maurice Duplessis (1936-1959). La démagogie avec laquelle Duplessis méprisait ses adversaires libéraux T.-D. Bouchard et G.-É. Lapalme; l’utilisation qu’il faisait du terrorisme de la Guerre Froide pour saisir - la célèbre loi du cadenas - les pamphlets de gauche; l’utilisation également qu’il faisait de la Police Provinciale pour matraquer les syndiqués; la manipulation idéologique du clergé catholique, le duplessisme était une politique démagogique de droite où l’autoritarisme se moquait du processus démocratique grâce à la corruption et au trafic des scrutins. Les récents scandales qui ont éclaboussé le gouvernement conservateur entraînés par des sénateurs rapaces et des conseillers maladroits ont, pour les Québécois, un air de déjà-vu. Mais Harper a hérité un autre aspect de la démagogie de Duplessis. Il ne se met pas lui-même en cause. Alors que l’Union Nationale, le parti politique de Duplessis, a rempli ses coffres et ceux de l'État avec la «petite loterie» des corrompus, Duplessis est mort plutôt pauvre. C’est avec l’argent de la corruption de l’Union Nationale que les Libéraux de Jean Lesage et de son «équipe du tonnerre» nous ont payé la Révolution tranquille de 1960. Harper et Duplessis, chacun à leur façon, font passer les intérêts de leur clientèle respective avant la satisfaction de leurs biens personnels. Le modèle duplessiste, et on l’oublie trop souvent, n’était pas propre au Québec mais se trouvait généralisé dans l’ensemble du Canada d’après-guerre. Malgré les discours sur «l’autonomie provinciale» de Duplessis, ce dernier partageait la même politique que son vis-à-vis ontarien de l’époque le libéral Mitchell Hepburn (1934-1942). Plus tard, le premier ministre Harris de l’Ontario (1995-2002), dont Harper a repris le ministre des finances Flaherty, a «bossé» sa province avec le même mépris conservateur de Duplessis. Enfin, l’Alberta n’est pas absente de ce décor sinistre avec le règne de Ralph Klein (1992-2006), un règne de 14 ans comparable au règne de Duplessis de 1944 à 1959, et sous lequel l’explosion économique de la province s’est réalisée. Avec la même brutalité, Harris et Klein ont mis les Ontariens et les Albertains sous la coupe des politiques budgétaires de compressions des dépenses de l’État pour laisser l’entreprise privée les mains libres d’agir comme bon lui semblait.
Le modèle duplessiste, et on l’oublie trop souvent, n’était pas propre au Québec mais se trouvait généralisé dans l’ensemble du Canada d’après-guerre. Malgré les discours sur «l’autonomie provinciale» de Duplessis, ce dernier partageait la même politique que son vis-à-vis ontarien de l’époque le libéral Mitchell Hepburn (1934-1942). Plus tard, le premier ministre Harris de l’Ontario (1995-2002), dont Harper a repris le ministre des finances Flaherty, a «bossé» sa province avec le même mépris conservateur de Duplessis. Enfin, l’Alberta n’est pas absente de ce décor sinistre avec le règne de Ralph Klein (1992-2006), un règne de 14 ans comparable au règne de Duplessis de 1944 à 1959, et sous lequel l’explosion économique de la province s’est réalisée. Avec la même brutalité, Harris et Klein ont mis les Ontariens et les Albertains sous la coupe des politiques budgétaires de compressions des dépenses de l’État pour laisser l’entreprise privée les mains libres d’agir comme bon lui semblait.  Duplessis et, à un moindre degré, Harris et Klein ont vendu les richesses naturelles et méprisées les ressources humaines avec une même désinvolture. Ce sont là les vrais précepteurs de Stephen Harper. On comprend mieux comment il a pu abroger la session de la Chambre des Communes pour se permettre de continuer à gouverner comme il l’entendait. Le fossé qu’il a creusé entre la Tribune journalistique et télévisuelle avait pour but de montrer qu’il n’avait que faire du «quatrième pouvoir» tant le seul vrai pouvoir réside entre les mains de ceux qui ont de l’argent. La force de la démagogie partisane, malgré les grincements de dents des «Alliancistes» qui voudraient voir revenir en quatrième vitesse la loi interdisant l’avortement et la peine de mort, lui permet de se garantir du côté de l’aile (extrême)-droite du Parti Conservateur. Elle lui est même utile tant elle rassure les mouvements gauchisants que, au fond, Harper reste le meilleur barrage contre les défoulements hystériques de ces républicains américains qui se sont trompés de pays.
Duplessis et, à un moindre degré, Harris et Klein ont vendu les richesses naturelles et méprisées les ressources humaines avec une même désinvolture. Ce sont là les vrais précepteurs de Stephen Harper. On comprend mieux comment il a pu abroger la session de la Chambre des Communes pour se permettre de continuer à gouverner comme il l’entendait. Le fossé qu’il a creusé entre la Tribune journalistique et télévisuelle avait pour but de montrer qu’il n’avait que faire du «quatrième pouvoir» tant le seul vrai pouvoir réside entre les mains de ceux qui ont de l’argent. La force de la démagogie partisane, malgré les grincements de dents des «Alliancistes» qui voudraient voir revenir en quatrième vitesse la loi interdisant l’avortement et la peine de mort, lui permet de se garantir du côté de l’aile (extrême)-droite du Parti Conservateur. Elle lui est même utile tant elle rassure les mouvements gauchisants que, au fond, Harper reste le meilleur barrage contre les défoulements hystériques de ces républicains américains qui se sont trompés de pays.2. Le mépris des peuples
Le corollaire de la démagogie est toujours le mépris des électeurs, en fait des peuples. Les Libéraux se sont scandalisés de la reconnaissance de la «nation» québécoise par le gouvernement conservateur et ce n’était là que des mots. Mais ce mot à en même temps montré qu’il ne signifiait plus grand chose au-delà du «sentiment d’appartenance» à une ethnie parmi d’autres. Mieux que le multiculturalisme à la Taylor et à la Trudeau, Harper a livré à Gérard Bouchard l’interculturalisme dont il se fait le défenseur. Le Canada est un devenu un lieu d’échanges entre différentes cultures sans![]() pour autant attribuer à aucune d’elles des «privilèges» autrement celui d’exprimer leurs traditions. En ce sens les individus ne sont plus noyés dans l’anonymat de l’isolisme, mais «parqués» dans des champs culturels (des ghettos imaginaires?) qui se doivent mutuels respects. Des centres urbains comme Vancouver, Toronto et même Montréal y trouvent leur profit, tandis qu’on peut librement parler de la «culture albertaine» ou de la «culture néo-écossaise» avec le même sérieux que la culture québécoise. Il ne suffirait qu’elles demandent la reconnaissance de leur «identité nationale» pour que le gouvernement conservateur le leur accorde. Nous revenons ainsi à l’antique définition féodale de la «nation» qui s’associait à toutes sortes de groupes unis par un caractère commun. Les femmes pouvaient, à elles seules, former une «nation» dans un royaume et, pourquoi pas, les gays et lesbiennes dans le monde du XXIe siècle?
pour autant attribuer à aucune d’elles des «privilèges» autrement celui d’exprimer leurs traditions. En ce sens les individus ne sont plus noyés dans l’anonymat de l’isolisme, mais «parqués» dans des champs culturels (des ghettos imaginaires?) qui se doivent mutuels respects. Des centres urbains comme Vancouver, Toronto et même Montréal y trouvent leur profit, tandis qu’on peut librement parler de la «culture albertaine» ou de la «culture néo-écossaise» avec le même sérieux que la culture québécoise. Il ne suffirait qu’elles demandent la reconnaissance de leur «identité nationale» pour que le gouvernement conservateur le leur accorde. Nous revenons ainsi à l’antique définition féodale de la «nation» qui s’associait à toutes sortes de groupes unis par un caractère commun. Les femmes pouvaient, à elles seules, former une «nation» dans un royaume et, pourquoi pas, les gays et lesbiennes dans le monde du XXIe siècle?
C’est dans cette optique qu’il faut comprendre la réaction viscérale du gouvernement du Parti Québécois à travers sa «charte de la laïcité». Cette chasse aux symboles religieux, autant qu’elle est pathétique, témoigne à quel point l’identité québécoise est au plus bas. Une collectivité - une nation - sûre d’elle-même ne crains pas les symboles autres que les siens. Plutôt qu’agir en majorité qui assimile les apports extérieurs, le projet![]() du Parti Québécois retombe dans la vieille maladie de l’ultramontanisme du XIXe siècle, c’est-à-dire bannir, refouler, repousser à sa circonférence, les «étranges» - comme on disait dans le bon vieux temps d’Hérouxville! -, et se camper sur un quant à soi défensif et obsidional qui va jusqu’à sacrifier le crucifix catholique avec le niqab de la musulmane, le turban du sikh ou «l’assiette à tarte velue» de l'hassidique. Cette façon de se nier soi-même dans son historicité et son Être collectif, s’insère insidieusement dans la façon de rejeter les autres dans leurs cultures et leurs traditions. Les suggestions de la politique Marois ouvrent à l’existence de ghettos fermés (y compris les régionalismes québécois) et s’engagent dans la trace laissée par les honteuses lois de Nuremberg de 1935 en interdisant implicitement l’accès à la fonction et aux services publiques pour ceux et celles qui refuseraient de cacher leurs signes distinctifs. Alors que ceux qui se décoreront la peau d'affreux tatouages, se grefferont le visage de piercings, ou se vêtiront de costumes fantaisistes pourront servir d'infirmières ou de professeurs! L’ultramontanisme conservateur et nationaliste du XIXe siècle renaît dans le nationalisme péquiste à la dérive, et c’est dans cette dérive que réside essentiellement le problème.
du Parti Québécois retombe dans la vieille maladie de l’ultramontanisme du XIXe siècle, c’est-à-dire bannir, refouler, repousser à sa circonférence, les «étranges» - comme on disait dans le bon vieux temps d’Hérouxville! -, et se camper sur un quant à soi défensif et obsidional qui va jusqu’à sacrifier le crucifix catholique avec le niqab de la musulmane, le turban du sikh ou «l’assiette à tarte velue» de l'hassidique. Cette façon de se nier soi-même dans son historicité et son Être collectif, s’insère insidieusement dans la façon de rejeter les autres dans leurs cultures et leurs traditions. Les suggestions de la politique Marois ouvrent à l’existence de ghettos fermés (y compris les régionalismes québécois) et s’engagent dans la trace laissée par les honteuses lois de Nuremberg de 1935 en interdisant implicitement l’accès à la fonction et aux services publiques pour ceux et celles qui refuseraient de cacher leurs signes distinctifs. Alors que ceux qui se décoreront la peau d'affreux tatouages, se grefferont le visage de piercings, ou se vêtiront de costumes fantaisistes pourront servir d'infirmières ou de professeurs! L’ultramontanisme conservateur et nationaliste du XIXe siècle renaît dans le nationalisme péquiste à la dérive, et c’est dans cette dérive que réside essentiellement le problème.
Bref, en reconnaissant la «nation québécoise», Stephen Harper l’a déstabilisée. Il lui a donné ce que les nationalistes libéraux du Québec demandaient depuis Robert Bourassa : la reconnaissance de la société distincte sans pour autant lui accorder plus qu'un droit de retrait avec compensation. Voilà pourquoi l’apprenti-chef du P.L.Q. Philippe Couillard s’avoue prêt à signer la Constitution de 1982 demain matin! C’est mieux que ce que les trente années des gouvernements Trudeau, Mulroney et Chrétien sont parvenus à obtenir. Ruse machiavélique? Bien évidemment, mais le résultat en vallait la peine.
Il en va de même avec les Autochtones. Ceux-ci étaient particulièrement «choyés» du temps des Trudeau, Chrétien et Paul Martin. Les Pow Wow avec longs chapeaux à plumes et calumets de paix qu'on se passait de main en main pendant que la pègre autochtone encaissait les chèques du gouvernement![]() fédéral et abandonnait leurs peuples à leurs conditions misérables est bien loin. Pour Harper, les «Premières nations» ne sont …que des nations. Comme les Québécois, ce sont des cultures en interconnexion les unes avec les autres. Pas de quoi déverser l’empathie des «sanglots longs de l’homme blanc», et la chef Theresa Spence pourra toujours poursuivre sa grève de la faim sous la fenêtre du Premier ministre, elle ne l’empêchera pas d’aller accueillir les deux pandas de Chine au zoo de Toronto. Idle-no-More n’est pas le Parti Québécois et la multiplication des pétitions que personne ne lit n’inquiète pas davantage. En ce sens, un gouvernement qui ne respecte pas ses peuples ne peut respecter davantage les autres peuples. Que le gouvernement conservateur coupe l’aide financière à des organismes qui font la promotion de la contraception dans des pays où se transmet le sida et ou la surpopulation crée des situations intolérables pour les plus pauvres, il sert ainsi les objectifs moraux de son électorat de la moral majority sans grever les mœurs canadiennes. En ce sens, le mépris que Machiavel - et le Prince - portaient aux hommes se retrouve dans les décisions politiques du gouvernement conservateur. L’indifférence aux changements climatiques avoue que ces hommes et ces femmes qui décident de l’avenir de l’ensemble des Canadiens, et non seulement de quelques groupes d’intérêts particuliers, font petite monnaie des conditions d’adaptation de l’avenir.
fédéral et abandonnait leurs peuples à leurs conditions misérables est bien loin. Pour Harper, les «Premières nations» ne sont …que des nations. Comme les Québécois, ce sont des cultures en interconnexion les unes avec les autres. Pas de quoi déverser l’empathie des «sanglots longs de l’homme blanc», et la chef Theresa Spence pourra toujours poursuivre sa grève de la faim sous la fenêtre du Premier ministre, elle ne l’empêchera pas d’aller accueillir les deux pandas de Chine au zoo de Toronto. Idle-no-More n’est pas le Parti Québécois et la multiplication des pétitions que personne ne lit n’inquiète pas davantage. En ce sens, un gouvernement qui ne respecte pas ses peuples ne peut respecter davantage les autres peuples. Que le gouvernement conservateur coupe l’aide financière à des organismes qui font la promotion de la contraception dans des pays où se transmet le sida et ou la surpopulation crée des situations intolérables pour les plus pauvres, il sert ainsi les objectifs moraux de son électorat de la moral majority sans grever les mœurs canadiennes. En ce sens, le mépris que Machiavel - et le Prince - portaient aux hommes se retrouve dans les décisions politiques du gouvernement conservateur. L’indifférence aux changements climatiques avoue que ces hommes et ces femmes qui décident de l’avenir de l’ensemble des Canadiens, et non seulement de quelques groupes d’intérêts particuliers, font petite monnaie des conditions d’adaptation de l’avenir.
Le corollaire de la démagogie est toujours le mépris des électeurs, en fait des peuples. Les Libéraux se sont scandalisés de la reconnaissance de la «nation» québécoise par le gouvernement conservateur et ce n’était là que des mots. Mais ce mot à en même temps montré qu’il ne signifiait plus grand chose au-delà du «sentiment d’appartenance» à une ethnie parmi d’autres. Mieux que le multiculturalisme à la Taylor et à la Trudeau, Harper a livré à Gérard Bouchard l’interculturalisme dont il se fait le défenseur. Le Canada est un devenu un lieu d’échanges entre différentes cultures sans
 pour autant attribuer à aucune d’elles des «privilèges» autrement celui d’exprimer leurs traditions. En ce sens les individus ne sont plus noyés dans l’anonymat de l’isolisme, mais «parqués» dans des champs culturels (des ghettos imaginaires?) qui se doivent mutuels respects. Des centres urbains comme Vancouver, Toronto et même Montréal y trouvent leur profit, tandis qu’on peut librement parler de la «culture albertaine» ou de la «culture néo-écossaise» avec le même sérieux que la culture québécoise. Il ne suffirait qu’elles demandent la reconnaissance de leur «identité nationale» pour que le gouvernement conservateur le leur accorde. Nous revenons ainsi à l’antique définition féodale de la «nation» qui s’associait à toutes sortes de groupes unis par un caractère commun. Les femmes pouvaient, à elles seules, former une «nation» dans un royaume et, pourquoi pas, les gays et lesbiennes dans le monde du XXIe siècle?
pour autant attribuer à aucune d’elles des «privilèges» autrement celui d’exprimer leurs traditions. En ce sens les individus ne sont plus noyés dans l’anonymat de l’isolisme, mais «parqués» dans des champs culturels (des ghettos imaginaires?) qui se doivent mutuels respects. Des centres urbains comme Vancouver, Toronto et même Montréal y trouvent leur profit, tandis qu’on peut librement parler de la «culture albertaine» ou de la «culture néo-écossaise» avec le même sérieux que la culture québécoise. Il ne suffirait qu’elles demandent la reconnaissance de leur «identité nationale» pour que le gouvernement conservateur le leur accorde. Nous revenons ainsi à l’antique définition féodale de la «nation» qui s’associait à toutes sortes de groupes unis par un caractère commun. Les femmes pouvaient, à elles seules, former une «nation» dans un royaume et, pourquoi pas, les gays et lesbiennes dans le monde du XXIe siècle?C’est dans cette optique qu’il faut comprendre la réaction viscérale du gouvernement du Parti Québécois à travers sa «charte de la laïcité». Cette chasse aux symboles religieux, autant qu’elle est pathétique, témoigne à quel point l’identité québécoise est au plus bas. Une collectivité - une nation - sûre d’elle-même ne crains pas les symboles autres que les siens. Plutôt qu’agir en majorité qui assimile les apports extérieurs, le projet
 du Parti Québécois retombe dans la vieille maladie de l’ultramontanisme du XIXe siècle, c’est-à-dire bannir, refouler, repousser à sa circonférence, les «étranges» - comme on disait dans le bon vieux temps d’Hérouxville! -, et se camper sur un quant à soi défensif et obsidional qui va jusqu’à sacrifier le crucifix catholique avec le niqab de la musulmane, le turban du sikh ou «l’assiette à tarte velue» de l'hassidique. Cette façon de se nier soi-même dans son historicité et son Être collectif, s’insère insidieusement dans la façon de rejeter les autres dans leurs cultures et leurs traditions. Les suggestions de la politique Marois ouvrent à l’existence de ghettos fermés (y compris les régionalismes québécois) et s’engagent dans la trace laissée par les honteuses lois de Nuremberg de 1935 en interdisant implicitement l’accès à la fonction et aux services publiques pour ceux et celles qui refuseraient de cacher leurs signes distinctifs. Alors que ceux qui se décoreront la peau d'affreux tatouages, se grefferont le visage de piercings, ou se vêtiront de costumes fantaisistes pourront servir d'infirmières ou de professeurs! L’ultramontanisme conservateur et nationaliste du XIXe siècle renaît dans le nationalisme péquiste à la dérive, et c’est dans cette dérive que réside essentiellement le problème.
du Parti Québécois retombe dans la vieille maladie de l’ultramontanisme du XIXe siècle, c’est-à-dire bannir, refouler, repousser à sa circonférence, les «étranges» - comme on disait dans le bon vieux temps d’Hérouxville! -, et se camper sur un quant à soi défensif et obsidional qui va jusqu’à sacrifier le crucifix catholique avec le niqab de la musulmane, le turban du sikh ou «l’assiette à tarte velue» de l'hassidique. Cette façon de se nier soi-même dans son historicité et son Être collectif, s’insère insidieusement dans la façon de rejeter les autres dans leurs cultures et leurs traditions. Les suggestions de la politique Marois ouvrent à l’existence de ghettos fermés (y compris les régionalismes québécois) et s’engagent dans la trace laissée par les honteuses lois de Nuremberg de 1935 en interdisant implicitement l’accès à la fonction et aux services publiques pour ceux et celles qui refuseraient de cacher leurs signes distinctifs. Alors que ceux qui se décoreront la peau d'affreux tatouages, se grefferont le visage de piercings, ou se vêtiront de costumes fantaisistes pourront servir d'infirmières ou de professeurs! L’ultramontanisme conservateur et nationaliste du XIXe siècle renaît dans le nationalisme péquiste à la dérive, et c’est dans cette dérive que réside essentiellement le problème.Bref, en reconnaissant la «nation québécoise», Stephen Harper l’a déstabilisée. Il lui a donné ce que les nationalistes libéraux du Québec demandaient depuis Robert Bourassa : la reconnaissance de la société distincte sans pour autant lui accorder plus qu'un droit de retrait avec compensation. Voilà pourquoi l’apprenti-chef du P.L.Q. Philippe Couillard s’avoue prêt à signer la Constitution de 1982 demain matin! C’est mieux que ce que les trente années des gouvernements Trudeau, Mulroney et Chrétien sont parvenus à obtenir. Ruse machiavélique? Bien évidemment, mais le résultat en vallait la peine.
Il en va de même avec les Autochtones. Ceux-ci étaient particulièrement «choyés» du temps des Trudeau, Chrétien et Paul Martin. Les Pow Wow avec longs chapeaux à plumes et calumets de paix qu'on se passait de main en main pendant que la pègre autochtone encaissait les chèques du gouvernement
 fédéral et abandonnait leurs peuples à leurs conditions misérables est bien loin. Pour Harper, les «Premières nations» ne sont …que des nations. Comme les Québécois, ce sont des cultures en interconnexion les unes avec les autres. Pas de quoi déverser l’empathie des «sanglots longs de l’homme blanc», et la chef Theresa Spence pourra toujours poursuivre sa grève de la faim sous la fenêtre du Premier ministre, elle ne l’empêchera pas d’aller accueillir les deux pandas de Chine au zoo de Toronto. Idle-no-More n’est pas le Parti Québécois et la multiplication des pétitions que personne ne lit n’inquiète pas davantage. En ce sens, un gouvernement qui ne respecte pas ses peuples ne peut respecter davantage les autres peuples. Que le gouvernement conservateur coupe l’aide financière à des organismes qui font la promotion de la contraception dans des pays où se transmet le sida et ou la surpopulation crée des situations intolérables pour les plus pauvres, il sert ainsi les objectifs moraux de son électorat de la moral majority sans grever les mœurs canadiennes. En ce sens, le mépris que Machiavel - et le Prince - portaient aux hommes se retrouve dans les décisions politiques du gouvernement conservateur. L’indifférence aux changements climatiques avoue que ces hommes et ces femmes qui décident de l’avenir de l’ensemble des Canadiens, et non seulement de quelques groupes d’intérêts particuliers, font petite monnaie des conditions d’adaptation de l’avenir.
fédéral et abandonnait leurs peuples à leurs conditions misérables est bien loin. Pour Harper, les «Premières nations» ne sont …que des nations. Comme les Québécois, ce sont des cultures en interconnexion les unes avec les autres. Pas de quoi déverser l’empathie des «sanglots longs de l’homme blanc», et la chef Theresa Spence pourra toujours poursuivre sa grève de la faim sous la fenêtre du Premier ministre, elle ne l’empêchera pas d’aller accueillir les deux pandas de Chine au zoo de Toronto. Idle-no-More n’est pas le Parti Québécois et la multiplication des pétitions que personne ne lit n’inquiète pas davantage. En ce sens, un gouvernement qui ne respecte pas ses peuples ne peut respecter davantage les autres peuples. Que le gouvernement conservateur coupe l’aide financière à des organismes qui font la promotion de la contraception dans des pays où se transmet le sida et ou la surpopulation crée des situations intolérables pour les plus pauvres, il sert ainsi les objectifs moraux de son électorat de la moral majority sans grever les mœurs canadiennes. En ce sens, le mépris que Machiavel - et le Prince - portaient aux hommes se retrouve dans les décisions politiques du gouvernement conservateur. L’indifférence aux changements climatiques avoue que ces hommes et ces femmes qui décident de l’avenir de l’ensemble des Canadiens, et non seulement de quelques groupes d’intérêts particuliers, font petite monnaie des conditions d’adaptation de l’avenir.3. L'effronterie internationale
D’où le mépris des peuples conduit à cette effronterie internationale qui s’est manifestée surtout dans la suite à donner au protocole de Kyoto sur les changements climatiques (2009). Tous les automobilistes, même les plus conscientisés à la question environnementale, ont été soulagés lorsque Stephen Harper a enterré la taxe sur le carbone que l’ex-ministre Stéphane Dion entendait imposer aux Canadiens. Que Stephen Harper soit l’homme![]() des pétrolières n’a rien d’extraordinaire en soi. Nous avons tous oublié les raisons pour lesquelles le gouvernement de Pierre Trudeau avait fondé et nationalisé Pétrocanada aux lendemains de la crise du pétrole en 1973, c’est-à-dire explorer afin d'exploiter le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta. Pour l’époque, les coûts mirobolants de l’entreprise coupèrent vite l’enthousiasme au ministre Marc Lalonde et la retombée des prix du pétrole suggéra que l’aventure n’en valait vraiment pas le coût. Si Trudeau et Lalonde avaient persisté dans leur décision, la colère que s’est attiré Harper serait retombée sur le Parti Libéral du Canada. En fait, Harper n’a fait que ressortir une vieille idée des tablettes. Évidemment, le but commercial de l’entreprise différait de l’orientation que lui donnaient les Libéraux, qui était, comme pour l’électricité au Québec, d’assurer l’indépendance énergétique et profiter des raffineries pour traiter le pétrole issu des terres canadiennes. Le but du gouvernement Harper est de vendre le pétrole aux Américains afin qu’ils ne touchent pas trop à leurs propres réserves. De l’auto-détermination énergétique nationale, nous avons régressé au statut de producteur colonial.
des pétrolières n’a rien d’extraordinaire en soi. Nous avons tous oublié les raisons pour lesquelles le gouvernement de Pierre Trudeau avait fondé et nationalisé Pétrocanada aux lendemains de la crise du pétrole en 1973, c’est-à-dire explorer afin d'exploiter le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta. Pour l’époque, les coûts mirobolants de l’entreprise coupèrent vite l’enthousiasme au ministre Marc Lalonde et la retombée des prix du pétrole suggéra que l’aventure n’en valait vraiment pas le coût. Si Trudeau et Lalonde avaient persisté dans leur décision, la colère que s’est attiré Harper serait retombée sur le Parti Libéral du Canada. En fait, Harper n’a fait que ressortir une vieille idée des tablettes. Évidemment, le but commercial de l’entreprise différait de l’orientation que lui donnaient les Libéraux, qui était, comme pour l’électricité au Québec, d’assurer l’indépendance énergétique et profiter des raffineries pour traiter le pétrole issu des terres canadiennes. Le but du gouvernement Harper est de vendre le pétrole aux Américains afin qu’ils ne touchent pas trop à leurs propres réserves. De l’auto-détermination énergétique nationale, nous avons régressé au statut de producteur colonial.
En retour, les plaintes adressées par les puissances étrangères, essentiellement européennes, concernent l’émission du CO2 dégagé essentiellement des automobiles à essence. Comme les grandes métropoles sont concentrées dans l’hémisphère nord, cette accumulation de gaz carbonique![]() produit plusieurs effets qui ne sont plus remis en doute par les autorités compétentes. L’effet de serres, qui, progressivement, transforme notre climat tempéré en climat subtropical, annonce qu’un jour, le pourtour des Grands Lacs et la vallée du Saint-Laurent ressembleront à une seconde vallée du Mississippi. Déjà la flore canadienne - «la flore laurentienne» si minutieusement dessinée par le Frère Marie-Victorin - subit des maux importés des climats du Sud. Et bientôt, ce sera autour de la faune à se voir chassée vers le nord par de nouveaux parasites ou de nouveaux prédateurs. Autre effet pervers, la fonte rapide des calottes polaires. Nous savons depuis 1960 environ que le réchauffement climatique a commencé à être perceptible dès les années 1860. À l’époque, il n’y avait pas de développement industriel de l’ampleur de celui qui fait aujourd’hui de la Terre une boule puante qui circule, toujours sur le même cycle, dans l'espace. Il n’y avait que l’Angleterre et la Belgique dont on pouvait dire qu’elles fonctionnaient avec des dépenses élevées de charbons et de matériaux fossiles. Le phénomène du réchauffement climatique est donc inscrit dans la chronologie géologique. À cela, la chronologie historique s’est ajoutée au changement naturel, et n’a cessé de l’accélérer depuis la substitution du pétrole au charbon. À cela, il faut ajouter que les écologistes n’ont cessé d’étendre le champ des émetteurs massifs de CO2, allant de la respiration humaine des mégapoles comme Mexico ou Tokyo aux pets de vaches d’élevages.
produit plusieurs effets qui ne sont plus remis en doute par les autorités compétentes. L’effet de serres, qui, progressivement, transforme notre climat tempéré en climat subtropical, annonce qu’un jour, le pourtour des Grands Lacs et la vallée du Saint-Laurent ressembleront à une seconde vallée du Mississippi. Déjà la flore canadienne - «la flore laurentienne» si minutieusement dessinée par le Frère Marie-Victorin - subit des maux importés des climats du Sud. Et bientôt, ce sera autour de la faune à se voir chassée vers le nord par de nouveaux parasites ou de nouveaux prédateurs. Autre effet pervers, la fonte rapide des calottes polaires. Nous savons depuis 1960 environ que le réchauffement climatique a commencé à être perceptible dès les années 1860. À l’époque, il n’y avait pas de développement industriel de l’ampleur de celui qui fait aujourd’hui de la Terre une boule puante qui circule, toujours sur le même cycle, dans l'espace. Il n’y avait que l’Angleterre et la Belgique dont on pouvait dire qu’elles fonctionnaient avec des dépenses élevées de charbons et de matériaux fossiles. Le phénomène du réchauffement climatique est donc inscrit dans la chronologie géologique. À cela, la chronologie historique s’est ajoutée au changement naturel, et n’a cessé de l’accélérer depuis la substitution du pétrole au charbon. À cela, il faut ajouter que les écologistes n’ont cessé d’étendre le champ des émetteurs massifs de CO2, allant de la respiration humaine des mégapoles comme Mexico ou Tokyo aux pets de vaches d’élevages.
La fonte des calottes polaires entraîne de ces effets perturbateurs, tel que l’écoulement de l’eau douce des glaciers qui, plus froide, vient![]() se mêler aux eaux salées et chaudes des océans. Le grand conducteur marin qui passe par le détroit du Labrador ne cesse de neutraliser le courant chaud du Gulf Stream et, par le fait même, souffle l'air froid sur le continent européen. Outre ce gaspillage insensé des eaux potables, il y a les émanations de méthane entraînées par la fonte du pergélisol. Ce méthane s’accumule dans l’atmosphère, augmentant les effets délétères de l’effet de serres. Le dome qui s’établit ainsi sur l’hémisphère nord doit être analysé non pas sous l’angle des transformations historiques, mais des changements de l’écosystème planétaire. Pour Stéphane Harper, toutes ces critiques intellectuelles relèvent d’un alarmisme qu’il associe au terrorisme. Dans la lignée du groupe dit des «Lucides» qui gravitait voilà quelques années autour de Lucien Bouchard, Stephen Harper refuse de se laisser arrêter par qui que ce soit qui dresse des constats «négatifs» face aux entreprises de développement économique. Cela vaut aussi bien pour les inquiétudes manifestées par les Européens que pour les pétitionnaires canadiens. En refusant de s’engager dans une véritable politique tenant compte des menaces écosystémiques, la pensée prospectiviste du gouvernement conservateur du Canada ne dépasse pas les limites de la chronologie historique.
se mêler aux eaux salées et chaudes des océans. Le grand conducteur marin qui passe par le détroit du Labrador ne cesse de neutraliser le courant chaud du Gulf Stream et, par le fait même, souffle l'air froid sur le continent européen. Outre ce gaspillage insensé des eaux potables, il y a les émanations de méthane entraînées par la fonte du pergélisol. Ce méthane s’accumule dans l’atmosphère, augmentant les effets délétères de l’effet de serres. Le dome qui s’établit ainsi sur l’hémisphère nord doit être analysé non pas sous l’angle des transformations historiques, mais des changements de l’écosystème planétaire. Pour Stéphane Harper, toutes ces critiques intellectuelles relèvent d’un alarmisme qu’il associe au terrorisme. Dans la lignée du groupe dit des «Lucides» qui gravitait voilà quelques années autour de Lucien Bouchard, Stephen Harper refuse de se laisser arrêter par qui que ce soit qui dresse des constats «négatifs» face aux entreprises de développement économique. Cela vaut aussi bien pour les inquiétudes manifestées par les Européens que pour les pétitionnaires canadiens. En refusant de s’engager dans une véritable politique tenant compte des menaces écosystémiques, la pensée prospectiviste du gouvernement conservateur du Canada ne dépasse pas les limites de la chronologie historique.
En fait, Stephen Harper fait une lecture «positive» des mêmes données et c’est par hypocrisie et duplicité, à l’image du Prince de Machiavel, qu'il nie les changements climatiques. Pour lui, ces![]() changements n’apportent pas que des effets pervers, effets qui seront lents à s’installer (pense-t-il) et qui permettront de renouveler les entreprises capitalistes en créant de nouveaux besoins afin d’adapter les Canadiens à leur nouvel environnement. Ce qu’il calcule, par contre, ce sont les opportunités économiques que lui offriront ces changements climatiques. Les économistes et les conseillers financiers du gouvernement conservateur mesurent l’étendue des bénéfices par la quantité de territoires aisément rentables qu’entraîneront ces changements. Avant même le fameux Plan Nord de l’ex-Premier ministre du Québec Jean Charest, il existait une politique d’expansionnisme, mieux, d’impérialisme nordique du gouvernement Canadien.
changements n’apportent pas que des effets pervers, effets qui seront lents à s’installer (pense-t-il) et qui permettront de renouveler les entreprises capitalistes en créant de nouveaux besoins afin d’adapter les Canadiens à leur nouvel environnement. Ce qu’il calcule, par contre, ce sont les opportunités économiques que lui offriront ces changements climatiques. Les économistes et les conseillers financiers du gouvernement conservateur mesurent l’étendue des bénéfices par la quantité de territoires aisément rentables qu’entraîneront ces changements. Avant même le fameux Plan Nord de l’ex-Premier ministre du Québec Jean Charest, il existait une politique d’expansionnisme, mieux, d’impérialisme nordique du gouvernement Canadien.
D’où le mépris des peuples conduit à cette effronterie internationale qui s’est manifestée surtout dans la suite à donner au protocole de Kyoto sur les changements climatiques (2009). Tous les automobilistes, même les plus conscientisés à la question environnementale, ont été soulagés lorsque Stephen Harper a enterré la taxe sur le carbone que l’ex-ministre Stéphane Dion entendait imposer aux Canadiens. Que Stephen Harper soit l’homme
 des pétrolières n’a rien d’extraordinaire en soi. Nous avons tous oublié les raisons pour lesquelles le gouvernement de Pierre Trudeau avait fondé et nationalisé Pétrocanada aux lendemains de la crise du pétrole en 1973, c’est-à-dire explorer afin d'exploiter le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta. Pour l’époque, les coûts mirobolants de l’entreprise coupèrent vite l’enthousiasme au ministre Marc Lalonde et la retombée des prix du pétrole suggéra que l’aventure n’en valait vraiment pas le coût. Si Trudeau et Lalonde avaient persisté dans leur décision, la colère que s’est attiré Harper serait retombée sur le Parti Libéral du Canada. En fait, Harper n’a fait que ressortir une vieille idée des tablettes. Évidemment, le but commercial de l’entreprise différait de l’orientation que lui donnaient les Libéraux, qui était, comme pour l’électricité au Québec, d’assurer l’indépendance énergétique et profiter des raffineries pour traiter le pétrole issu des terres canadiennes. Le but du gouvernement Harper est de vendre le pétrole aux Américains afin qu’ils ne touchent pas trop à leurs propres réserves. De l’auto-détermination énergétique nationale, nous avons régressé au statut de producteur colonial.
des pétrolières n’a rien d’extraordinaire en soi. Nous avons tous oublié les raisons pour lesquelles le gouvernement de Pierre Trudeau avait fondé et nationalisé Pétrocanada aux lendemains de la crise du pétrole en 1973, c’est-à-dire explorer afin d'exploiter le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta. Pour l’époque, les coûts mirobolants de l’entreprise coupèrent vite l’enthousiasme au ministre Marc Lalonde et la retombée des prix du pétrole suggéra que l’aventure n’en valait vraiment pas le coût. Si Trudeau et Lalonde avaient persisté dans leur décision, la colère que s’est attiré Harper serait retombée sur le Parti Libéral du Canada. En fait, Harper n’a fait que ressortir une vieille idée des tablettes. Évidemment, le but commercial de l’entreprise différait de l’orientation que lui donnaient les Libéraux, qui était, comme pour l’électricité au Québec, d’assurer l’indépendance énergétique et profiter des raffineries pour traiter le pétrole issu des terres canadiennes. Le but du gouvernement Harper est de vendre le pétrole aux Américains afin qu’ils ne touchent pas trop à leurs propres réserves. De l’auto-détermination énergétique nationale, nous avons régressé au statut de producteur colonial.En retour, les plaintes adressées par les puissances étrangères, essentiellement européennes, concernent l’émission du CO2 dégagé essentiellement des automobiles à essence. Comme les grandes métropoles sont concentrées dans l’hémisphère nord, cette accumulation de gaz carbonique
 produit plusieurs effets qui ne sont plus remis en doute par les autorités compétentes. L’effet de serres, qui, progressivement, transforme notre climat tempéré en climat subtropical, annonce qu’un jour, le pourtour des Grands Lacs et la vallée du Saint-Laurent ressembleront à une seconde vallée du Mississippi. Déjà la flore canadienne - «la flore laurentienne» si minutieusement dessinée par le Frère Marie-Victorin - subit des maux importés des climats du Sud. Et bientôt, ce sera autour de la faune à se voir chassée vers le nord par de nouveaux parasites ou de nouveaux prédateurs. Autre effet pervers, la fonte rapide des calottes polaires. Nous savons depuis 1960 environ que le réchauffement climatique a commencé à être perceptible dès les années 1860. À l’époque, il n’y avait pas de développement industriel de l’ampleur de celui qui fait aujourd’hui de la Terre une boule puante qui circule, toujours sur le même cycle, dans l'espace. Il n’y avait que l’Angleterre et la Belgique dont on pouvait dire qu’elles fonctionnaient avec des dépenses élevées de charbons et de matériaux fossiles. Le phénomène du réchauffement climatique est donc inscrit dans la chronologie géologique. À cela, la chronologie historique s’est ajoutée au changement naturel, et n’a cessé de l’accélérer depuis la substitution du pétrole au charbon. À cela, il faut ajouter que les écologistes n’ont cessé d’étendre le champ des émetteurs massifs de CO2, allant de la respiration humaine des mégapoles comme Mexico ou Tokyo aux pets de vaches d’élevages.
produit plusieurs effets qui ne sont plus remis en doute par les autorités compétentes. L’effet de serres, qui, progressivement, transforme notre climat tempéré en climat subtropical, annonce qu’un jour, le pourtour des Grands Lacs et la vallée du Saint-Laurent ressembleront à une seconde vallée du Mississippi. Déjà la flore canadienne - «la flore laurentienne» si minutieusement dessinée par le Frère Marie-Victorin - subit des maux importés des climats du Sud. Et bientôt, ce sera autour de la faune à se voir chassée vers le nord par de nouveaux parasites ou de nouveaux prédateurs. Autre effet pervers, la fonte rapide des calottes polaires. Nous savons depuis 1960 environ que le réchauffement climatique a commencé à être perceptible dès les années 1860. À l’époque, il n’y avait pas de développement industriel de l’ampleur de celui qui fait aujourd’hui de la Terre une boule puante qui circule, toujours sur le même cycle, dans l'espace. Il n’y avait que l’Angleterre et la Belgique dont on pouvait dire qu’elles fonctionnaient avec des dépenses élevées de charbons et de matériaux fossiles. Le phénomène du réchauffement climatique est donc inscrit dans la chronologie géologique. À cela, la chronologie historique s’est ajoutée au changement naturel, et n’a cessé de l’accélérer depuis la substitution du pétrole au charbon. À cela, il faut ajouter que les écologistes n’ont cessé d’étendre le champ des émetteurs massifs de CO2, allant de la respiration humaine des mégapoles comme Mexico ou Tokyo aux pets de vaches d’élevages.La fonte des calottes polaires entraîne de ces effets perturbateurs, tel que l’écoulement de l’eau douce des glaciers qui, plus froide, vient
 se mêler aux eaux salées et chaudes des océans. Le grand conducteur marin qui passe par le détroit du Labrador ne cesse de neutraliser le courant chaud du Gulf Stream et, par le fait même, souffle l'air froid sur le continent européen. Outre ce gaspillage insensé des eaux potables, il y a les émanations de méthane entraînées par la fonte du pergélisol. Ce méthane s’accumule dans l’atmosphère, augmentant les effets délétères de l’effet de serres. Le dome qui s’établit ainsi sur l’hémisphère nord doit être analysé non pas sous l’angle des transformations historiques, mais des changements de l’écosystème planétaire. Pour Stéphane Harper, toutes ces critiques intellectuelles relèvent d’un alarmisme qu’il associe au terrorisme. Dans la lignée du groupe dit des «Lucides» qui gravitait voilà quelques années autour de Lucien Bouchard, Stephen Harper refuse de se laisser arrêter par qui que ce soit qui dresse des constats «négatifs» face aux entreprises de développement économique. Cela vaut aussi bien pour les inquiétudes manifestées par les Européens que pour les pétitionnaires canadiens. En refusant de s’engager dans une véritable politique tenant compte des menaces écosystémiques, la pensée prospectiviste du gouvernement conservateur du Canada ne dépasse pas les limites de la chronologie historique.
se mêler aux eaux salées et chaudes des océans. Le grand conducteur marin qui passe par le détroit du Labrador ne cesse de neutraliser le courant chaud du Gulf Stream et, par le fait même, souffle l'air froid sur le continent européen. Outre ce gaspillage insensé des eaux potables, il y a les émanations de méthane entraînées par la fonte du pergélisol. Ce méthane s’accumule dans l’atmosphère, augmentant les effets délétères de l’effet de serres. Le dome qui s’établit ainsi sur l’hémisphère nord doit être analysé non pas sous l’angle des transformations historiques, mais des changements de l’écosystème planétaire. Pour Stéphane Harper, toutes ces critiques intellectuelles relèvent d’un alarmisme qu’il associe au terrorisme. Dans la lignée du groupe dit des «Lucides» qui gravitait voilà quelques années autour de Lucien Bouchard, Stephen Harper refuse de se laisser arrêter par qui que ce soit qui dresse des constats «négatifs» face aux entreprises de développement économique. Cela vaut aussi bien pour les inquiétudes manifestées par les Européens que pour les pétitionnaires canadiens. En refusant de s’engager dans une véritable politique tenant compte des menaces écosystémiques, la pensée prospectiviste du gouvernement conservateur du Canada ne dépasse pas les limites de la chronologie historique.En fait, Stephen Harper fait une lecture «positive» des mêmes données et c’est par hypocrisie et duplicité, à l’image du Prince de Machiavel, qu'il nie les changements climatiques. Pour lui, ces
 changements n’apportent pas que des effets pervers, effets qui seront lents à s’installer (pense-t-il) et qui permettront de renouveler les entreprises capitalistes en créant de nouveaux besoins afin d’adapter les Canadiens à leur nouvel environnement. Ce qu’il calcule, par contre, ce sont les opportunités économiques que lui offriront ces changements climatiques. Les économistes et les conseillers financiers du gouvernement conservateur mesurent l’étendue des bénéfices par la quantité de territoires aisément rentables qu’entraîneront ces changements. Avant même le fameux Plan Nord de l’ex-Premier ministre du Québec Jean Charest, il existait une politique d’expansionnisme, mieux, d’impérialisme nordique du gouvernement Canadien.
changements n’apportent pas que des effets pervers, effets qui seront lents à s’installer (pense-t-il) et qui permettront de renouveler les entreprises capitalistes en créant de nouveaux besoins afin d’adapter les Canadiens à leur nouvel environnement. Ce qu’il calcule, par contre, ce sont les opportunités économiques que lui offriront ces changements climatiques. Les économistes et les conseillers financiers du gouvernement conservateur mesurent l’étendue des bénéfices par la quantité de territoires aisément rentables qu’entraîneront ces changements. Avant même le fameux Plan Nord de l’ex-Premier ministre du Québec Jean Charest, il existait une politique d’expansionnisme, mieux, d’impérialisme nordique du gouvernement Canadien.4. L'impérialisme nordique
![]() Cet impérialisme nordique se définit par deux orientations d’État. D’abord étendre l’exploitation des richesses minières et pétrolifères jusqu’au cercle polaire. De l’Alberta vers le Nord, il s’agira de pénétrer dans les Territoires du Nord-Ouest où les nappes de pétrole se prolongent et promettent des quantités inespérées de barils de pétrole. Alors qu'au cours des années 2000, l'échéance des nappes de pétroles se situait à 40 ans avant l’épuisement des réserves planétaires, ce nouveau pactole pétrolier annonce que le Canada pourrait devenir, d'ici peu de temps, un joueur majeur à la table des Nations productrices de Pétrole (O.P.E.P.) et jouer sur le cours des prix.
Cet impérialisme nordique se définit par deux orientations d’État. D’abord étendre l’exploitation des richesses minières et pétrolifères jusqu’au cercle polaire. De l’Alberta vers le Nord, il s’agira de pénétrer dans les Territoires du Nord-Ouest où les nappes de pétrole se prolongent et promettent des quantités inespérées de barils de pétrole. Alors qu'au cours des années 2000, l'échéance des nappes de pétroles se situait à 40 ans avant l’épuisement des réserves planétaires, ce nouveau pactole pétrolier annonce que le Canada pourrait devenir, d'ici peu de temps, un joueur majeur à la table des Nations productrices de Pétrole (O.P.E.P.) et jouer sur le cours des prix.
Le second élément qui constitue l’objectif de l’impérialisme nordique est la fonte des glaces polaires et la libération de l’Océan Arctique au cours des prochaines décennies qui rendront possible un navigation à l’année longue. Ce faisant, le![]() trafic maritime européen vers l’Asie sera détourné du canal de Panama pour passer directement de la Mer du Nord au détroit du Labrador et de là, suivra point par point les nouvelles cités que le gouvernement canadien parsèmera sur les côtes océanes jusqu’en Alaska. De là, le trafic maritime européen, passant par le détroit de Behring, arrivera à Vladivostok, à Tokyo et aux ports chinois. Détournant le trafic du canal de Panama afin de diminuer sur les coûts de transport entre le marché européen et le marché chinois, nous percevons mieux les démarches parallèles du gouvernement Harper de resserrer les liens avec Pékin tout en s’affairant à avaliser un traîté de libre-échange avec la Communauté Économique Européenne.
trafic maritime européen vers l’Asie sera détourné du canal de Panama pour passer directement de la Mer du Nord au détroit du Labrador et de là, suivra point par point les nouvelles cités que le gouvernement canadien parsèmera sur les côtes océanes jusqu’en Alaska. De là, le trafic maritime européen, passant par le détroit de Behring, arrivera à Vladivostok, à Tokyo et aux ports chinois. Détournant le trafic du canal de Panama afin de diminuer sur les coûts de transport entre le marché européen et le marché chinois, nous percevons mieux les démarches parallèles du gouvernement Harper de resserrer les liens avec Pékin tout en s’affairant à avaliser un traîté de libre-échange avec la Communauté Économique Européenne.
Les Européens retiendront-ils alors le souvenir de la gifle de Kyoto? Devant une telle perspective, les groupes d’intérêts européens auront vite compris où ils pourront bénéficier des retombées des changements climatiques. Après tout, les affairistes européens, tout comme les affairistes canadiens, savent bien que la seule chronologie dont il faille tenir compte est la chronologie historique. De plus, l’Europe de l’Ouest, dont le pétrole vient des champs pétrolifères de Roumanie et des anciens territoires soviétiques de l’Azerbaïdjan, du Caucase, de l’Ukraine et de la Georgie, maintenant républiques autonomes, vont se trouver sur le chemin du retour à l’État russe.
Ici, j’ouvre une parenthèse pour les effets que pourrait avoir un raidissement de la politique russe dans la diplomatie internationale. Si le![]() président Obama peut se permettre à l’émission populaire américaine animée par Jay Leno de déclarer que nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle période de «guerre froide» avec la Russie, ce n’est pas seulement pour des vétilles concernant la guerre civile de Syrie ou les mesures anti-gaies prises par le gouvernement Poutine. Il est bien évident que Vladimir Poutine n’entend pas se laisser dépasser par l’extrême-droite nationaliste et qu’il veut reformer l’unité «nationale» russe. À ce titre, les jeux olympiques de Sochi sont moins pour épater le monde occidental des prouesses russes qu’à des fins de consommation interne. Il serait même profitable, pour le gouvernement Poutine, que le boycott des jeux de Moscou de 1980 se reproduit et d’ici février 2014, rien ne dit qu’il ne disposera pas ses pions diplomatiques de façon à créer une accumulation de
président Obama peut se permettre à l’émission populaire américaine animée par Jay Leno de déclarer que nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle période de «guerre froide» avec la Russie, ce n’est pas seulement pour des vétilles concernant la guerre civile de Syrie ou les mesures anti-gaies prises par le gouvernement Poutine. Il est bien évident que Vladimir Poutine n’entend pas se laisser dépasser par l’extrême-droite nationaliste et qu’il veut reformer l’unité «nationale» russe. À ce titre, les jeux olympiques de Sochi sont moins pour épater le monde occidental des prouesses russes qu’à des fins de consommation interne. Il serait même profitable, pour le gouvernement Poutine, que le boycott des jeux de Moscou de 1980 se reproduit et d’ici février 2014, rien ne dit qu’il ne disposera pas ses pions diplomatiques de façon à créer une accumulation de ![]() frustrations occidentales qui entraînera un tel boycott. Sochi, ville artificielle née de la démagogie poutinienne, vise à redorer le blason de l’ancien empire des tsars autocrates et du Soviet Suprême après vingt ans de déboires anarchiques. Il est impensable que ces territoires qui ont obtenu leur indépendance nationale aux lendemains de l’effondrement de l’Union soviétique ne reviennent pas, un jour ou l’autre, à l’intérieur de l’État universel russe. L’Ukraine est le cœur de la civilisation chrétienne-orthodoxe dans sa version Russe. Kiev fut la première capitale de l’État russe, coincé à l’époque entre la Horde d’or mongole et la pénétration par le royaume Polono-Lithuanien. Que l’agenda soit ouvert ou tenu caché, la politique de Moscou restera toujours la même depuis des siècles : retrouver les territoires perdus au cours de la dernière décennie du XXe siècle. Une telle entreprise, si elle venait tôt ou tard à se réaliser, risquerait de priver l’Europe occidentale du pétrole d'Asie mineure ou à l’obtenir à des prix prohibitifs.
frustrations occidentales qui entraînera un tel boycott. Sochi, ville artificielle née de la démagogie poutinienne, vise à redorer le blason de l’ancien empire des tsars autocrates et du Soviet Suprême après vingt ans de déboires anarchiques. Il est impensable que ces territoires qui ont obtenu leur indépendance nationale aux lendemains de l’effondrement de l’Union soviétique ne reviennent pas, un jour ou l’autre, à l’intérieur de l’État universel russe. L’Ukraine est le cœur de la civilisation chrétienne-orthodoxe dans sa version Russe. Kiev fut la première capitale de l’État russe, coincé à l’époque entre la Horde d’or mongole et la pénétration par le royaume Polono-Lithuanien. Que l’agenda soit ouvert ou tenu caché, la politique de Moscou restera toujours la même depuis des siècles : retrouver les territoires perdus au cours de la dernière décennie du XXe siècle. Une telle entreprise, si elle venait tôt ou tard à se réaliser, risquerait de priver l’Europe occidentale du pétrole d'Asie mineure ou à l’obtenir à des prix prohibitifs.
On comprend dès lors l’importance de l’impérialisme nordique canadien. D’une part, le libre-échange Europe de l’Ouest/Canada créera pour ce dernier un marché du pétrole où les acheteurs se soucieront peu s’il provient des sables bitumineux -![]() présentés récemment par un ministre canadien comme étant un «pétrole écologique» [sic!] -, ce qui, je tiens à le rappeler, n’a suscité aucune hilarité de la part des auditeurs européens, contrairement à l’effet qu’une telle absurdité aurait déclenchée il y a de ça à peine deux ou trois ans -, et un accès sur une période de temps réduite au vaste marché extrême-oriental, par la voie océane Arctique. Comme un nouvel Alexandre le Grand, Stephen Harper arpente chaque année la bordure océane de l’Arctique pour voir le résultat des changements climatiques et planifier la construction de nouveaux ports maritimes ou la mise à jour de sites existant déjà. Il y aura ainsi, comme les Alexandries de jadis, des Harperopolis, de Kuujjuaq au Québec à la limite de la frontière du Yukon et de l’Alaska.
présentés récemment par un ministre canadien comme étant un «pétrole écologique» [sic!] -, ce qui, je tiens à le rappeler, n’a suscité aucune hilarité de la part des auditeurs européens, contrairement à l’effet qu’une telle absurdité aurait déclenchée il y a de ça à peine deux ou trois ans -, et un accès sur une période de temps réduite au vaste marché extrême-oriental, par la voie océane Arctique. Comme un nouvel Alexandre le Grand, Stephen Harper arpente chaque année la bordure océane de l’Arctique pour voir le résultat des changements climatiques et planifier la construction de nouveaux ports maritimes ou la mise à jour de sites existant déjà. Il y aura ainsi, comme les Alexandries de jadis, des Harperopolis, de Kuujjuaq au Québec à la limite de la frontière du Yukon et de l’Alaska.
 Cet impérialisme nordique se définit par deux orientations d’État. D’abord étendre l’exploitation des richesses minières et pétrolifères jusqu’au cercle polaire. De l’Alberta vers le Nord, il s’agira de pénétrer dans les Territoires du Nord-Ouest où les nappes de pétrole se prolongent et promettent des quantités inespérées de barils de pétrole. Alors qu'au cours des années 2000, l'échéance des nappes de pétroles se situait à 40 ans avant l’épuisement des réserves planétaires, ce nouveau pactole pétrolier annonce que le Canada pourrait devenir, d'ici peu de temps, un joueur majeur à la table des Nations productrices de Pétrole (O.P.E.P.) et jouer sur le cours des prix.
Cet impérialisme nordique se définit par deux orientations d’État. D’abord étendre l’exploitation des richesses minières et pétrolifères jusqu’au cercle polaire. De l’Alberta vers le Nord, il s’agira de pénétrer dans les Territoires du Nord-Ouest où les nappes de pétrole se prolongent et promettent des quantités inespérées de barils de pétrole. Alors qu'au cours des années 2000, l'échéance des nappes de pétroles se situait à 40 ans avant l’épuisement des réserves planétaires, ce nouveau pactole pétrolier annonce que le Canada pourrait devenir, d'ici peu de temps, un joueur majeur à la table des Nations productrices de Pétrole (O.P.E.P.) et jouer sur le cours des prix.Le second élément qui constitue l’objectif de l’impérialisme nordique est la fonte des glaces polaires et la libération de l’Océan Arctique au cours des prochaines décennies qui rendront possible un navigation à l’année longue. Ce faisant, le
 trafic maritime européen vers l’Asie sera détourné du canal de Panama pour passer directement de la Mer du Nord au détroit du Labrador et de là, suivra point par point les nouvelles cités que le gouvernement canadien parsèmera sur les côtes océanes jusqu’en Alaska. De là, le trafic maritime européen, passant par le détroit de Behring, arrivera à Vladivostok, à Tokyo et aux ports chinois. Détournant le trafic du canal de Panama afin de diminuer sur les coûts de transport entre le marché européen et le marché chinois, nous percevons mieux les démarches parallèles du gouvernement Harper de resserrer les liens avec Pékin tout en s’affairant à avaliser un traîté de libre-échange avec la Communauté Économique Européenne.
trafic maritime européen vers l’Asie sera détourné du canal de Panama pour passer directement de la Mer du Nord au détroit du Labrador et de là, suivra point par point les nouvelles cités que le gouvernement canadien parsèmera sur les côtes océanes jusqu’en Alaska. De là, le trafic maritime européen, passant par le détroit de Behring, arrivera à Vladivostok, à Tokyo et aux ports chinois. Détournant le trafic du canal de Panama afin de diminuer sur les coûts de transport entre le marché européen et le marché chinois, nous percevons mieux les démarches parallèles du gouvernement Harper de resserrer les liens avec Pékin tout en s’affairant à avaliser un traîté de libre-échange avec la Communauté Économique Européenne.Les Européens retiendront-ils alors le souvenir de la gifle de Kyoto? Devant une telle perspective, les groupes d’intérêts européens auront vite compris où ils pourront bénéficier des retombées des changements climatiques. Après tout, les affairistes européens, tout comme les affairistes canadiens, savent bien que la seule chronologie dont il faille tenir compte est la chronologie historique. De plus, l’Europe de l’Ouest, dont le pétrole vient des champs pétrolifères de Roumanie et des anciens territoires soviétiques de l’Azerbaïdjan, du Caucase, de l’Ukraine et de la Georgie, maintenant républiques autonomes, vont se trouver sur le chemin du retour à l’État russe.
Ici, j’ouvre une parenthèse pour les effets que pourrait avoir un raidissement de la politique russe dans la diplomatie internationale. Si le
 président Obama peut se permettre à l’émission populaire américaine animée par Jay Leno de déclarer que nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle période de «guerre froide» avec la Russie, ce n’est pas seulement pour des vétilles concernant la guerre civile de Syrie ou les mesures anti-gaies prises par le gouvernement Poutine. Il est bien évident que Vladimir Poutine n’entend pas se laisser dépasser par l’extrême-droite nationaliste et qu’il veut reformer l’unité «nationale» russe. À ce titre, les jeux olympiques de Sochi sont moins pour épater le monde occidental des prouesses russes qu’à des fins de consommation interne. Il serait même profitable, pour le gouvernement Poutine, que le boycott des jeux de Moscou de 1980 se reproduit et d’ici février 2014, rien ne dit qu’il ne disposera pas ses pions diplomatiques de façon à créer une accumulation de
président Obama peut se permettre à l’émission populaire américaine animée par Jay Leno de déclarer que nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle période de «guerre froide» avec la Russie, ce n’est pas seulement pour des vétilles concernant la guerre civile de Syrie ou les mesures anti-gaies prises par le gouvernement Poutine. Il est bien évident que Vladimir Poutine n’entend pas se laisser dépasser par l’extrême-droite nationaliste et qu’il veut reformer l’unité «nationale» russe. À ce titre, les jeux olympiques de Sochi sont moins pour épater le monde occidental des prouesses russes qu’à des fins de consommation interne. Il serait même profitable, pour le gouvernement Poutine, que le boycott des jeux de Moscou de 1980 se reproduit et d’ici février 2014, rien ne dit qu’il ne disposera pas ses pions diplomatiques de façon à créer une accumulation de  frustrations occidentales qui entraînera un tel boycott. Sochi, ville artificielle née de la démagogie poutinienne, vise à redorer le blason de l’ancien empire des tsars autocrates et du Soviet Suprême après vingt ans de déboires anarchiques. Il est impensable que ces territoires qui ont obtenu leur indépendance nationale aux lendemains de l’effondrement de l’Union soviétique ne reviennent pas, un jour ou l’autre, à l’intérieur de l’État universel russe. L’Ukraine est le cœur de la civilisation chrétienne-orthodoxe dans sa version Russe. Kiev fut la première capitale de l’État russe, coincé à l’époque entre la Horde d’or mongole et la pénétration par le royaume Polono-Lithuanien. Que l’agenda soit ouvert ou tenu caché, la politique de Moscou restera toujours la même depuis des siècles : retrouver les territoires perdus au cours de la dernière décennie du XXe siècle. Une telle entreprise, si elle venait tôt ou tard à se réaliser, risquerait de priver l’Europe occidentale du pétrole d'Asie mineure ou à l’obtenir à des prix prohibitifs.
frustrations occidentales qui entraînera un tel boycott. Sochi, ville artificielle née de la démagogie poutinienne, vise à redorer le blason de l’ancien empire des tsars autocrates et du Soviet Suprême après vingt ans de déboires anarchiques. Il est impensable que ces territoires qui ont obtenu leur indépendance nationale aux lendemains de l’effondrement de l’Union soviétique ne reviennent pas, un jour ou l’autre, à l’intérieur de l’État universel russe. L’Ukraine est le cœur de la civilisation chrétienne-orthodoxe dans sa version Russe. Kiev fut la première capitale de l’État russe, coincé à l’époque entre la Horde d’or mongole et la pénétration par le royaume Polono-Lithuanien. Que l’agenda soit ouvert ou tenu caché, la politique de Moscou restera toujours la même depuis des siècles : retrouver les territoires perdus au cours de la dernière décennie du XXe siècle. Une telle entreprise, si elle venait tôt ou tard à se réaliser, risquerait de priver l’Europe occidentale du pétrole d'Asie mineure ou à l’obtenir à des prix prohibitifs. On comprend dès lors l’importance de l’impérialisme nordique canadien. D’une part, le libre-échange Europe de l’Ouest/Canada créera pour ce dernier un marché du pétrole où les acheteurs se soucieront peu s’il provient des sables bitumineux -
 présentés récemment par un ministre canadien comme étant un «pétrole écologique» [sic!] -, ce qui, je tiens à le rappeler, n’a suscité aucune hilarité de la part des auditeurs européens, contrairement à l’effet qu’une telle absurdité aurait déclenchée il y a de ça à peine deux ou trois ans -, et un accès sur une période de temps réduite au vaste marché extrême-oriental, par la voie océane Arctique. Comme un nouvel Alexandre le Grand, Stephen Harper arpente chaque année la bordure océane de l’Arctique pour voir le résultat des changements climatiques et planifier la construction de nouveaux ports maritimes ou la mise à jour de sites existant déjà. Il y aura ainsi, comme les Alexandries de jadis, des Harperopolis, de Kuujjuaq au Québec à la limite de la frontière du Yukon et de l’Alaska.
présentés récemment par un ministre canadien comme étant un «pétrole écologique» [sic!] -, ce qui, je tiens à le rappeler, n’a suscité aucune hilarité de la part des auditeurs européens, contrairement à l’effet qu’une telle absurdité aurait déclenchée il y a de ça à peine deux ou trois ans -, et un accès sur une période de temps réduite au vaste marché extrême-oriental, par la voie océane Arctique. Comme un nouvel Alexandre le Grand, Stephen Harper arpente chaque année la bordure océane de l’Arctique pour voir le résultat des changements climatiques et planifier la construction de nouveaux ports maritimes ou la mise à jour de sites existant déjà. Il y aura ainsi, comme les Alexandries de jadis, des Harperopolis, de Kuujjuaq au Québec à la limite de la frontière du Yukon et de l’Alaska.5. Développement du militarisme
Voilà pourquoi l’impérialisme nordique suscite le développement d’un militarisme effréné des forces maritimes et aériennes du Canada. Stephen Harper sait qu’il y a deux puissances qui seront prêtes à lui disputer le contrôle de l’Arctique. La Russie et les États-Unis. Le seul prétendant sérieux sont les États-Unis. D’abord, à cause des milliards de dollars qu’ils perdront annuellement suite au
 déplacement du trafic maritime de Panama à l’Arctique. Ensuite, dans le but de maintenir la défense du glacis nord-américain qui est l’une de leur hantise depuis l’attaque de septembre 2001. Si pro-américain que soit le gouvernement Harper, si pro-républicain soit-il également au niveau de la morale sociale, le gouvernement de Stephen Harper doit d’abord privilégier les intérêts financiers canadiens. Ceux de son Alberta natale comme de l’ensemble de l’unité qui court désormais A mari usque ad mare usque ad mare. Si Wilfrid Laurier s’est grossièrement trompé en qualifiant le XXe siècle de siècle du Canada, Stephen Harper entend bien reprendre au XXIe le rendez-vous manqué, et tout semble ici confirmer sa poétique géographique et historique. C’est ainsi que nous pouvons comprendre les efforts déployés en 2012-2013 pour fêter le bicentenaire de la guerre de 1812. Je ne reviendrai pas ici sur la question discutée ailleurs sur les causes psychologiques de cette nécessité de célébrer une needless war, mais le fait seulement de rappeler que les intérêts du Canada ne sont pas toujours convergents avec ceux des États-Unis. Si les deux pays collaborent étroitement sur de nombreux points, dont la défense du glacis nord-américain où Ottawa est inféodé à Washington depuis la Guerre Froide, l’exploitation du Grand Nord canadien va nécessiter des modifications houleuses dans les relations entre les deux pays.
déplacement du trafic maritime de Panama à l’Arctique. Ensuite, dans le but de maintenir la défense du glacis nord-américain qui est l’une de leur hantise depuis l’attaque de septembre 2001. Si pro-américain que soit le gouvernement Harper, si pro-républicain soit-il également au niveau de la morale sociale, le gouvernement de Stephen Harper doit d’abord privilégier les intérêts financiers canadiens. Ceux de son Alberta natale comme de l’ensemble de l’unité qui court désormais A mari usque ad mare usque ad mare. Si Wilfrid Laurier s’est grossièrement trompé en qualifiant le XXe siècle de siècle du Canada, Stephen Harper entend bien reprendre au XXIe le rendez-vous manqué, et tout semble ici confirmer sa poétique géographique et historique. C’est ainsi que nous pouvons comprendre les efforts déployés en 2012-2013 pour fêter le bicentenaire de la guerre de 1812. Je ne reviendrai pas ici sur la question discutée ailleurs sur les causes psychologiques de cette nécessité de célébrer une needless war, mais le fait seulement de rappeler que les intérêts du Canada ne sont pas toujours convergents avec ceux des États-Unis. Si les deux pays collaborent étroitement sur de nombreux points, dont la défense du glacis nord-américain où Ottawa est inféodé à Washington depuis la Guerre Froide, l’exploitation du Grand Nord canadien va nécessiter des modifications houleuses dans les relations entre les deux pays.À ce titre la présence militaire - la construction de nouveaux sous-marins et de nouveaux navires de guerre ainsi que l’équipement aéronautique - se trouve au cœur des dépenses gouvernementales. Si le reste de la population doit constamment vivre sous des compressions budgétaires, des diminutions de
 services publiques, de déréglementations et de déresponsabilisation des ministères, la «défense» du Canada exige la «modernisation» de ses équipements et surtout de sa technologie. C'est en ce sens qu'il faut situer le fameux débat sur les F-18 ou encore l'énorme financement du chantier naval Irving d'Halifax. Personne ne se demande sincèrement «qui menace» le Canada? Avant même que la question ne lui soit posée, Stephen Harper répond «le terrorisme» qui, dans son imagination, va de Al-Qaïda à Greenpeace! Le moindre esprit critique s’aperçoit très vite du manque de sérieux de ces citrouilles d’Halloween. La vraie réponse est à anticiper en fonction de l’impérialisme arctique, et rien d’autres. Un impérialisme que Stephen Harper est prêt à soutenir même contre ses alliés américains.
services publiques, de déréglementations et de déresponsabilisation des ministères, la «défense» du Canada exige la «modernisation» de ses équipements et surtout de sa technologie. C'est en ce sens qu'il faut situer le fameux débat sur les F-18 ou encore l'énorme financement du chantier naval Irving d'Halifax. Personne ne se demande sincèrement «qui menace» le Canada? Avant même que la question ne lui soit posée, Stephen Harper répond «le terrorisme» qui, dans son imagination, va de Al-Qaïda à Greenpeace! Le moindre esprit critique s’aperçoit très vite du manque de sérieux de ces citrouilles d’Halloween. La vraie réponse est à anticiper en fonction de l’impérialisme arctique, et rien d’autres. Un impérialisme que Stephen Harper est prêt à soutenir même contre ses alliés américains.D’où l’importance d’entretenir le nationalisme canadien et de renforcer la fantasmatique des anciens liens avec l’Empire britannique. Aux défaillances britanniques, le Canada se substitue comme l’héritier naturel de Londres. Son culte de la reine et des symboles monarchiques vise à défaire les vieux complexes psychologiques canadiens face ![]() à l’arrogance américaine. Ce n’est pas par hasard que les journalistes canadiens, tant anglophones que francophones, ont été indignés par la façon dont le film Argo de Ben Affleck - qui met en vedette le réalisateur même - présentait le rôle des Canadiens dans l’évasion de six diplomates américains de l’ambassade à Téhéran en 1980. Pour comprendre cette levée de bouclier, il faut avoir à l’esprit trois points : 1º l’évasion des diplomates américains par l’ambassade canadienne s’est déroulée à l’époque du gouvernement conservateur de Joe Clark; 2º Argo s’est mérité l’Oscar du meilleur film de l’année 2013 et l’Oscar du meilleur scénario; 3º la version cinématographique déforme sciemment et cruellement la narration des faits historiques. Dans le film Argo, la C.I.A. est présentée comme la maîtresse du jeu dans l’évasion des diplomates d’Iran alors que l’ambassadeur canadien, Kenneth Taylor, est présenté comme un mollusque. Dans les faits, il a dû protéger, confiné et caché dans l’ambassade canadienne, les six diplomates pendant 79 jours tant la C.I.A. ne parvenait pas à se décider à mener l’opération à termes. Bref, le film de Ben Affleck est un insulte à la fierté canadienne d’avoir droit, pour une fois, à la reconnaissance du peuple Américain dans une entreprise diplomatique délicate où les Canadiens risquaient leur peau autant que les diplomates évadés.
à l’arrogance américaine. Ce n’est pas par hasard que les journalistes canadiens, tant anglophones que francophones, ont été indignés par la façon dont le film Argo de Ben Affleck - qui met en vedette le réalisateur même - présentait le rôle des Canadiens dans l’évasion de six diplomates américains de l’ambassade à Téhéran en 1980. Pour comprendre cette levée de bouclier, il faut avoir à l’esprit trois points : 1º l’évasion des diplomates américains par l’ambassade canadienne s’est déroulée à l’époque du gouvernement conservateur de Joe Clark; 2º Argo s’est mérité l’Oscar du meilleur film de l’année 2013 et l’Oscar du meilleur scénario; 3º la version cinématographique déforme sciemment et cruellement la narration des faits historiques. Dans le film Argo, la C.I.A. est présentée comme la maîtresse du jeu dans l’évasion des diplomates d’Iran alors que l’ambassadeur canadien, Kenneth Taylor, est présenté comme un mollusque. Dans les faits, il a dû protéger, confiné et caché dans l’ambassade canadienne, les six diplomates pendant 79 jours tant la C.I.A. ne parvenait pas à se décider à mener l’opération à termes. Bref, le film de Ben Affleck est un insulte à la fierté canadienne d’avoir droit, pour une fois, à la reconnaissance du peuple Américain dans une entreprise diplomatique délicate où les Canadiens risquaient leur peau autant que les diplomates évadés.
 à l’arrogance américaine. Ce n’est pas par hasard que les journalistes canadiens, tant anglophones que francophones, ont été indignés par la façon dont le film Argo de Ben Affleck - qui met en vedette le réalisateur même - présentait le rôle des Canadiens dans l’évasion de six diplomates américains de l’ambassade à Téhéran en 1980. Pour comprendre cette levée de bouclier, il faut avoir à l’esprit trois points : 1º l’évasion des diplomates américains par l’ambassade canadienne s’est déroulée à l’époque du gouvernement conservateur de Joe Clark; 2º Argo s’est mérité l’Oscar du meilleur film de l’année 2013 et l’Oscar du meilleur scénario; 3º la version cinématographique déforme sciemment et cruellement la narration des faits historiques. Dans le film Argo, la C.I.A. est présentée comme la maîtresse du jeu dans l’évasion des diplomates d’Iran alors que l’ambassadeur canadien, Kenneth Taylor, est présenté comme un mollusque. Dans les faits, il a dû protéger, confiné et caché dans l’ambassade canadienne, les six diplomates pendant 79 jours tant la C.I.A. ne parvenait pas à se décider à mener l’opération à termes. Bref, le film de Ben Affleck est un insulte à la fierté canadienne d’avoir droit, pour une fois, à la reconnaissance du peuple Américain dans une entreprise diplomatique délicate où les Canadiens risquaient leur peau autant que les diplomates évadés.
à l’arrogance américaine. Ce n’est pas par hasard que les journalistes canadiens, tant anglophones que francophones, ont été indignés par la façon dont le film Argo de Ben Affleck - qui met en vedette le réalisateur même - présentait le rôle des Canadiens dans l’évasion de six diplomates américains de l’ambassade à Téhéran en 1980. Pour comprendre cette levée de bouclier, il faut avoir à l’esprit trois points : 1º l’évasion des diplomates américains par l’ambassade canadienne s’est déroulée à l’époque du gouvernement conservateur de Joe Clark; 2º Argo s’est mérité l’Oscar du meilleur film de l’année 2013 et l’Oscar du meilleur scénario; 3º la version cinématographique déforme sciemment et cruellement la narration des faits historiques. Dans le film Argo, la C.I.A. est présentée comme la maîtresse du jeu dans l’évasion des diplomates d’Iran alors que l’ambassadeur canadien, Kenneth Taylor, est présenté comme un mollusque. Dans les faits, il a dû protéger, confiné et caché dans l’ambassade canadienne, les six diplomates pendant 79 jours tant la C.I.A. ne parvenait pas à se décider à mener l’opération à termes. Bref, le film de Ben Affleck est un insulte à la fierté canadienne d’avoir droit, pour une fois, à la reconnaissance du peuple Américain dans une entreprise diplomatique délicate où les Canadiens risquaient leur peau autant que les diplomates évadés. Il est indéniable que Ben Affleck est un «crosseur», et pour ceux qui n’en seraient pas convaincus, ils n’ont qu’à regarder jusqu’au bout ce court extrait d’une entrevue qu’il accordait à Dick. Il est indispensable de bien suivre le débit de l’entrevue, car la parole de M. Affleck dépasse son imagination. Mais, si nous revenons au nationalisme canadien, il est important de conserver à l’esprit que l’entreprise de l'impérialisme arctique nécessite derrière elle une population fière, virile, militarisée et se tenant au service de son gouvernement. Il y aura trop d’argent en jeu pour se laisser dépouiller même si, présentement, il s’agit de jouer le jeu du colonisé. Il faut, pour les projets d'avenir, préparer la population canadienne face aux Américains et face aux Européens. L’opération 1812 visait à rappeler que non seulement les Canadiens ont déjà résisté aux incursions de leurs voisins du Sud, aguichés par les richesses canadiennes, mais qu’ils ont gagné cette guerre de 1812 - qui, dans les faits, s’est soldée par un
Il est indéniable que Ben Affleck est un «crosseur», et pour ceux qui n’en seraient pas convaincus, ils n’ont qu’à regarder jusqu’au bout ce court extrait d’une entrevue qu’il accordait à Dick. Il est indispensable de bien suivre le débit de l’entrevue, car la parole de M. Affleck dépasse son imagination. Mais, si nous revenons au nationalisme canadien, il est important de conserver à l’esprit que l’entreprise de l'impérialisme arctique nécessite derrière elle une population fière, virile, militarisée et se tenant au service de son gouvernement. Il y aura trop d’argent en jeu pour se laisser dépouiller même si, présentement, il s’agit de jouer le jeu du colonisé. Il faut, pour les projets d'avenir, préparer la population canadienne face aux Américains et face aux Européens. L’opération 1812 visait à rappeler que non seulement les Canadiens ont déjà résisté aux incursions de leurs voisins du Sud, aguichés par les richesses canadiennes, mais qu’ils ont gagné cette guerre de 1812 - qui, dans les faits, s’est soldée par un  match nul. Ensuite, face aux Européens, les célébrations du centenaire de la Grande Guerre, qui commenceront en 2014, seront là pour leur rappeler que durant les deux guerres mondiales du XXe siècle, les Canadiens se sont volontairement engagés dans la guerre aux côtés des alliés, et ce bien des années avant les Américains. Qu’ils ont lutté avec les autres coloniaux britanniques sur les champs de bataille de France et de Belgique : Aux batailles d'Ypres, à la crête de Vimy, les batailles de Courcelette et de Passchendaele où sont tombés tant de soldats canadiens, doivent être remémorées dans l’esprit des Européens aussi bien que des Canadiens avec lesquels les privilèges du libre-marché devraient être reconnus. La portée idéologique du nationalisme, d’un côté ou de l’autre, intérieur comme extérieur, n’est jamais gratuit ou innocent.
match nul. Ensuite, face aux Européens, les célébrations du centenaire de la Grande Guerre, qui commenceront en 2014, seront là pour leur rappeler que durant les deux guerres mondiales du XXe siècle, les Canadiens se sont volontairement engagés dans la guerre aux côtés des alliés, et ce bien des années avant les Américains. Qu’ils ont lutté avec les autres coloniaux britanniques sur les champs de bataille de France et de Belgique : Aux batailles d'Ypres, à la crête de Vimy, les batailles de Courcelette et de Passchendaele où sont tombés tant de soldats canadiens, doivent être remémorées dans l’esprit des Européens aussi bien que des Canadiens avec lesquels les privilèges du libre-marché devraient être reconnus. La portée idéologique du nationalisme, d’un côté ou de l’autre, intérieur comme extérieur, n’est jamais gratuit ou innocent.7. L'anti-intellectualisme primaire
L’anti-intellectualisme primaire avec lequel le gouvernement Harper traite des questions politiques et sociales est le complément d’une recherche de la passivité populaire et citoyenne. Cultiver la
 paranoïa du terrorisme écologique, diminuer les subventions d’aide à la culture, engager la virilité canadienne dans le militarisme et «l’agressivité défensive», surveiller les mœurs et les réseaux sociaux afin qu’il n’y ait ni écarts de conduite privée ni propagandes «anti-canadiennes», ramènent aux politiques démagogiques dont nous parlions en début d’article. Le culte du souvenir d’une histoire du Canada chargée de victoires militaires et d’engagements pour les valeurs de liberté et de démocratie sont là pour nourrir la fantasmatique et non la progressive application de ces valeurs. Comme la République n’avait pas besoin de savants, l’Empire de la nordicité canadienne n’a pas besoin de critiques, de philosophes et d’historiens. Il faut laisser Stephen Harper suivre son cours.
paranoïa du terrorisme écologique, diminuer les subventions d’aide à la culture, engager la virilité canadienne dans le militarisme et «l’agressivité défensive», surveiller les mœurs et les réseaux sociaux afin qu’il n’y ait ni écarts de conduite privée ni propagandes «anti-canadiennes», ramènent aux politiques démagogiques dont nous parlions en début d’article. Le culte du souvenir d’une histoire du Canada chargée de victoires militaires et d’engagements pour les valeurs de liberté et de démocratie sont là pour nourrir la fantasmatique et non la progressive application de ces valeurs. Comme la République n’avait pas besoin de savants, l’Empire de la nordicité canadienne n’a pas besoin de critiques, de philosophes et d’historiens. Il faut laisser Stephen Harper suivre son cours.En conclusion, il faut donc reconnaître que Stephen Harper est, de tous les hommes politiques canadiens actuels, le seul à avoir un programme économique, politique, diplomatique et social. C’est un programme démagogique, insolent au niveau international, méprisant au niveau citoyen, impérialiste et militariste, nationaliste et anti-intellectuel. C’est une politique des Contre-Lumières mise au service de groupes d’intérêts particuliers et non de la population canadienne. C’est une poétique de l’espace et du temps centrée autour d’une intrigue projetée dans l’avenir selon les conditions de transformations écosystémiques et économiques. Pour cette raison, cela fait du gouvernement Harper un gouvernement cohérent, machiavélique, suffisant et dangereux⌛
Montréal
22 août 2013
22 août 2013