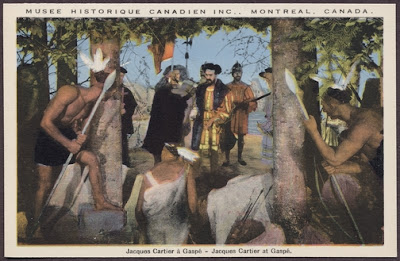Convenons-en une fois pour toutes, Montréal est une ville laide. Depuis quarante ans, les différents conseils municipaux qui se sont succédés ont essayé de la rendre attrayante en démolissant ses entrepôts grouillants de vermines, ses![]() lieux de réfrigération éventrés, ses hangars recouverts de feuilles de métal qui absorbaient la chaleur du soleil en été et allumaient des incendies à partir des structures de bois imbibées d’huile, ses trottoirs crevassés et ses rues remplies de nids de poule dans lesquels on se tord les chevilles, accidents pour lesquels la municipalité se dégage de toutes responsabilités. Montréal reste, malgré tous ces efforts, une ville laide, à peine urbanisée dans le sens architectural. Usant périodiquement d'une thérapie au botox bitumineux, l'imaginaire urbain enduit de vieilles maisons ouvrières d'un mica qui les transforme en chaumières petite-bourgeoises pour bobos du Plateau Mont-Royal ou résidents de l’ancien Faubourg à m‘lasse, aujourd’hui centré sur le quartier gay.
lieux de réfrigération éventrés, ses hangars recouverts de feuilles de métal qui absorbaient la chaleur du soleil en été et allumaient des incendies à partir des structures de bois imbibées d’huile, ses trottoirs crevassés et ses rues remplies de nids de poule dans lesquels on se tord les chevilles, accidents pour lesquels la municipalité se dégage de toutes responsabilités. Montréal reste, malgré tous ces efforts, une ville laide, à peine urbanisée dans le sens architectural. Usant périodiquement d'une thérapie au botox bitumineux, l'imaginaire urbain enduit de vieilles maisons ouvrières d'un mica qui les transforme en chaumières petite-bourgeoises pour bobos du Plateau Mont-Royal ou résidents de l’ancien Faubourg à m‘lasse, aujourd’hui centré sur le quartier gay.
À un pâté de maisons de chez moi, au coin des rues Rachel et Iberville, il y a un édifice converti depuis quelques années en condos. Il y a 20 ans, lorsque je suis venu résidé à l’endroit où je demeure présentement, c’était un bunker, un édifice dont les fenêtres, du sous-sol au dernier étage,![]() étaient murées de ciment. Avec raison, car c’était un entrepôt où s’entassaient des dizaines de milliers de pneus usagés. Et avant ça, cet édifice n’était nulle autre que la manufacture de chaussures Lagrenade, où les felquistes, le 5 mai 1966, lors d'un conflit ouvrier, avaient fait sauter un colis piégé, tuant une secrétaire. C’est à la fois troublant et mystérieux chaque fois que je vois ce vieux bout de film en noir et blanc des actualités de l’époque qui nous montre la civière portant le cadavre de Mme Morin passant par la porte par où, aujourd’hui, défilent les «branchés» qui habitent l’endroit. La plupart d’entre eux, j’en suis sûr, ignorent le drame terrible qui s’est passé là, bien avant même leur conception! De la manufacture Lagrenade au bunker de tires, au condo de bobos c’est un demi-siècle d’évolution de l’histoire d’un bâtiment que nous détenons-là. Est-il plus «beau» aujourd’hui qu’à l’époque? Son style s’est adapté à chaque nouvelle fonction. Seulement, il est toujours aussi laid.
étaient murées de ciment. Avec raison, car c’était un entrepôt où s’entassaient des dizaines de milliers de pneus usagés. Et avant ça, cet édifice n’était nulle autre que la manufacture de chaussures Lagrenade, où les felquistes, le 5 mai 1966, lors d'un conflit ouvrier, avaient fait sauter un colis piégé, tuant une secrétaire. C’est à la fois troublant et mystérieux chaque fois que je vois ce vieux bout de film en noir et blanc des actualités de l’époque qui nous montre la civière portant le cadavre de Mme Morin passant par la porte par où, aujourd’hui, défilent les «branchés» qui habitent l’endroit. La plupart d’entre eux, j’en suis sûr, ignorent le drame terrible qui s’est passé là, bien avant même leur conception! De la manufacture Lagrenade au bunker de tires, au condo de bobos c’est un demi-siècle d’évolution de l’histoire d’un bâtiment que nous détenons-là. Est-il plus «beau» aujourd’hui qu’à l’époque? Son style s’est adapté à chaque nouvelle fonction. Seulement, il est toujours aussi laid.
Voilà maintenant qu’un groupe d’artistes s’unit pour créer un album esthétique sur un édifice qui s’apprête également à être renippé en condos, au coin des rues Ontario et Papineau; l’ancien hôtel Jolicœur. Cet hôtel au joli cœur était en fait un![]() bazar de corps humains. L’hôtel Jolicœur, en effet, était un hôtel de passe. Moi, qui ai habité quelques années au coin des rues Ontario et Des Érables, il m’arrivait de passer devant quotidiennement. C'était au temps où la rue Ontario était encore une rue peu recommandable, avec un vieil entrepôt reconverti en quincaillerie qui avait conservé sur son mur en briques extérieur une vieille publicité peinte de Quaker Oats du début du XXe siècle! Les «bineries» étaient minables. Les commerces délabrés. Les magasins d’antiquité, de vrais ramassis de marchés aux puces. On y trouvait un marchand de tabac célèbre, qui y réside toujours, et l’Association des Père Noël qui n’y est plus. Au milieu trônaient deux grandes églises aux dimensions de cathédrales et qui étendaient le
bazar de corps humains. L’hôtel Jolicœur, en effet, était un hôtel de passe. Moi, qui ai habité quelques années au coin des rues Ontario et Des Érables, il m’arrivait de passer devant quotidiennement. C'était au temps où la rue Ontario était encore une rue peu recommandable, avec un vieil entrepôt reconverti en quincaillerie qui avait conservé sur son mur en briques extérieur une vieille publicité peinte de Quaker Oats du début du XXe siècle! Les «bineries» étaient minables. Les commerces délabrés. Les magasins d’antiquité, de vrais ramassis de marchés aux puces. On y trouvait un marchand de tabac célèbre, qui y réside toujours, et l’Association des Père Noël qui n’y est plus. Au milieu trônaient deux grandes églises aux dimensions de cathédrales et qui étendaient le ![]() pouvoir clérical sur cette masse d’habitants pauvres, esseulés ou dotés de familles nombreuses, des travailleurs ou ouvrières des manufactures du quartier. À partir des années 90, le quartier gay est venu s’établir sur la rue Sainte-Catherine. La prostitution féminine se trouva repoussée sur la rue Ontario. Comme les endroits sombres et les arrières-cours y sont nombreux, il y a de la place pour toutes les passes possibles. L’hôtel Jolicœur n’était pas le moins fréquenté de la place. Pendant qu’au rez-de-chaussée on buvait à profusion, les chambres aux étages étaient occupées par des prostituées en fin de carrière, alcooliques ou droguées, battues, violentées et même probablement tuées. De tout le quartier, il y avait là le cercle le plus profond de l’Enfer, où les damnées venaient y pousser leur dernier râle. Le temps de nettoyer les murs ou les planchers souillés, et une autre venait prendre la place de celle qui n’était plus.
pouvoir clérical sur cette masse d’habitants pauvres, esseulés ou dotés de familles nombreuses, des travailleurs ou ouvrières des manufactures du quartier. À partir des années 90, le quartier gay est venu s’établir sur la rue Sainte-Catherine. La prostitution féminine se trouva repoussée sur la rue Ontario. Comme les endroits sombres et les arrières-cours y sont nombreux, il y a de la place pour toutes les passes possibles. L’hôtel Jolicœur n’était pas le moins fréquenté de la place. Pendant qu’au rez-de-chaussée on buvait à profusion, les chambres aux étages étaient occupées par des prostituées en fin de carrière, alcooliques ou droguées, battues, violentées et même probablement tuées. De tout le quartier, il y avait là le cercle le plus profond de l’Enfer, où les damnées venaient y pousser leur dernier râle. Le temps de nettoyer les murs ou les planchers souillés, et une autre venait prendre la place de celle qui n’était plus.
C’est une sensation beaucoup plus qu’un sentiment, et donc difficile à définir avec des mots. Je me souviens l’avoir ressenti une première (et une rare)![]() fois en regardant, vers l’âge de 16 ans, la photo de la pièce, dans la cave de la Maison Ipatiev, où la famille du tsar Nicolas II avait été exécutée à coups de pistolets (1918). La porte fermée, les trous de balles dans les murs, les morceaux de boiseries fauchés par la mitraille, les débris de toutes sortes jonchant le plancher. Je me suis senti sur le coup envahi par une stupeur, une stupeur au sens étymologique du terme, comme un petit animal fasciné par un serpent. La Mort. La mort violente avait été là. Et Elle était encore visible sur le vieux cliché. Depuis, j’ai revu cette scène bien souvent et dans le compte-rendu de l’enquête Sokoloff, tous les clichés photométriques de la scène y sont. De sorte, que je ne ressens plus guère cette première sensation quand je regarde aujourd'hui la photographie tragique.
fois en regardant, vers l’âge de 16 ans, la photo de la pièce, dans la cave de la Maison Ipatiev, où la famille du tsar Nicolas II avait été exécutée à coups de pistolets (1918). La porte fermée, les trous de balles dans les murs, les morceaux de boiseries fauchés par la mitraille, les débris de toutes sortes jonchant le plancher. Je me suis senti sur le coup envahi par une stupeur, une stupeur au sens étymologique du terme, comme un petit animal fasciné par un serpent. La Mort. La mort violente avait été là. Et Elle était encore visible sur le vieux cliché. Depuis, j’ai revu cette scène bien souvent et dans le compte-rendu de l’enquête Sokoloff, tous les clichés photométriques de la scène y sont. De sorte, que je ne ressens plus guère cette première sensation quand je regarde aujourd'hui la photographie tragique.
![]() En Amérique, toutes les villes ont leurs quartiers sordides. New York, Chicago, Los Angeles ont leurs lieux maudits où ont été assassiné ou suicidé telle ou telle personne. Il m’arrive de recevoir, parmi mes «sources de trafic» sur mon blogue, des gens qui demandent à voir le 10050 Cielo Drive, la demeure Polanski, où fut jadis éventrée et tuée l’actrice Sharon Tate ainsi que quatre autres personnes. Là aussi, surtout sur les clichés en noir et blanc, nous percevons la même sensation de la Mort présente, même une fois les cadavres évacués.
En Amérique, toutes les villes ont leurs quartiers sordides. New York, Chicago, Los Angeles ont leurs lieux maudits où ont été assassiné ou suicidé telle ou telle personne. Il m’arrive de recevoir, parmi mes «sources de trafic» sur mon blogue, des gens qui demandent à voir le 10050 Cielo Drive, la demeure Polanski, où fut jadis éventrée et tuée l’actrice Sharon Tate ainsi que quatre autres personnes. Là aussi, surtout sur les clichés en noir et blanc, nous percevons la même sensation de la Mort présente, même une fois les cadavres évacués.
Peut-être, effectivement, la technique du noir et blanc rend-t-elle ces scènes de crimes plus «efficaces» dans la perception sensorielle du spectateur. Les clichés en couleurs du 10050 Cielo Drive, avec les corps sanglants encore sur la moquette du tapis, ne me donnent pas la même sensation. L’horreur, le dégoût certainement, le pathos, mais pas la sensation de la présence inscrite de la Mort. Même![]() chose lorsque je regarde des clichés couleurs du garde-manger de Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. Par contre, que dire des scènes en noir et blanc du film Being at home with Claude, de Jean Beaudin (1992), montrant la rencontre du prostitué avec un étudiant en littérature - dont il deviendra l’amant et finira par l’égorger au cours d’une scène de baise torride -, qui présente le «petit parc des Portugais», coin Saint-Laurent et Marie-Anne, pendant que se déroule le Festival de Jazz? Jamais, je crois, un cinéaste a réussi à rendre aussi bien compte par ces quelques séquences, les meilleures du film, de cette inquiétante étrangeté qui hante Montréal, la nuit, sous la moiteur de l'été.
chose lorsque je regarde des clichés couleurs du garde-manger de Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. Par contre, que dire des scènes en noir et blanc du film Being at home with Claude, de Jean Beaudin (1992), montrant la rencontre du prostitué avec un étudiant en littérature - dont il deviendra l’amant et finira par l’égorger au cours d’une scène de baise torride -, qui présente le «petit parc des Portugais», coin Saint-Laurent et Marie-Anne, pendant que se déroule le Festival de Jazz? Jamais, je crois, un cinéaste a réussi à rendre aussi bien compte par ces quelques séquences, les meilleures du film, de cette inquiétante étrangeté qui hante Montréal, la nuit, sous la moiteur de l'été.
Les policiers qui, au printemps 2012, découvrirent le tronc mutilé de l'étudiant chinois emballé dans une valise à Côte-des-Neiges durent éprouver une stupeur semblable, et encore bien plus traumatisante. Mais ceci dit, ayant vu la vidéo de Luka Magnotta, je n’ai rien ressenti d’une pareille stupeur semblable à celle![]() éprouvée devant la photo de la cave de la Maison Ipatiev. Pourquoi? Parce que la vidéo était en couleur me direz-vous? Non. Je ne le pense pas. Même en noir et blanc, ce film me fut resté long, ennuyeux, et sauf respect pour la victime, d'une banalité de l’horreur sordide et obscène. Même la Mort, semble-t-il, n’aime pas être mêlée à des exhibitionnismes de ce genre. Peut-être a-t-elle un certain respect d’elle-même qui fait que bien peu d’entre nous allons mourir à la manière d’un Jun Lin. C’est parce que cette sensation de stupeur qu’elle provoque en nous est difficile à traduire que, pour la saisir, les films et les séries d’horreur sont-ils obligés d’amplifier les scènes de torture morale et de meurtre. Détailler les corps dépecés, décapités, démembrés, écorchés. Ce sont-là des morts beaucoup plus fantasmatiques et littéraires que réelles. Ayant vécu de près la mort de ma mère, je dois reconnaître aujourd'hui, que tout se fait paisiblement, grâce sans doute aux médicaments qui assurent la transition de la souffrance vers «l'état cadavérique», mais la mort de la personne n’a plus rien d’horrifiant en soi. Ce n’est que lorsque la peau commence à se déshydrater et à coller aux muscles et aux os que toute la laideur du cadavre apparaît et
éprouvée devant la photo de la cave de la Maison Ipatiev. Pourquoi? Parce que la vidéo était en couleur me direz-vous? Non. Je ne le pense pas. Même en noir et blanc, ce film me fut resté long, ennuyeux, et sauf respect pour la victime, d'une banalité de l’horreur sordide et obscène. Même la Mort, semble-t-il, n’aime pas être mêlée à des exhibitionnismes de ce genre. Peut-être a-t-elle un certain respect d’elle-même qui fait que bien peu d’entre nous allons mourir à la manière d’un Jun Lin. C’est parce que cette sensation de stupeur qu’elle provoque en nous est difficile à traduire que, pour la saisir, les films et les séries d’horreur sont-ils obligés d’amplifier les scènes de torture morale et de meurtre. Détailler les corps dépecés, décapités, démembrés, écorchés. Ce sont-là des morts beaucoup plus fantasmatiques et littéraires que réelles. Ayant vécu de près la mort de ma mère, je dois reconnaître aujourd'hui, que tout se fait paisiblement, grâce sans doute aux médicaments qui assurent la transition de la souffrance vers «l'état cadavérique», mais la mort de la personne n’a plus rien d’horrifiant en soi. Ce n’est que lorsque la peau commence à se déshydrater et à coller aux muscles et aux os que toute la laideur du cadavre apparaît et ![]() qu’il vaut mieux partir afin de ne pas laisser cette image devenir la dernière de la personne aimée. Mais même, je me répète, le moment de sa mort n'a pas suscité en moi une sensation pareille. La Mort qui se laisse voir a besoin d’une atmosphère qui lui est propice. Les lieux où ont été commis des crimes inouïs - nous pensons à Auschwitz plus particulièrement -, laissent voir la grimace de la Mort, peut-être parce que nous savons que ces morts n’ont pas été «naturelles». Que ces morts ont été le fruit de la méchanceté humaine, de la psychopathologie de grands criminels. Mais la banalité de l’horreur ne cède en rien à l'inquiétante étrangeté des lieux. L’hôtel Jolicœur, pour ne pas être le motel Bates, n’en était pas moins un lieu où se sont commis les transactions de corps entre des clients, violents ou honteux, et des prostituées droguées et moralement suicidées.
qu’il vaut mieux partir afin de ne pas laisser cette image devenir la dernière de la personne aimée. Mais même, je me répète, le moment de sa mort n'a pas suscité en moi une sensation pareille. La Mort qui se laisse voir a besoin d’une atmosphère qui lui est propice. Les lieux où ont été commis des crimes inouïs - nous pensons à Auschwitz plus particulièrement -, laissent voir la grimace de la Mort, peut-être parce que nous savons que ces morts n’ont pas été «naturelles». Que ces morts ont été le fruit de la méchanceté humaine, de la psychopathologie de grands criminels. Mais la banalité de l’horreur ne cède en rien à l'inquiétante étrangeté des lieux. L’hôtel Jolicœur, pour ne pas être le motel Bates, n’en était pas moins un lieu où se sont commis les transactions de corps entre des clients, violents ou honteux, et des prostituées droguées et moralement suicidées.
Lorsque nous regardons ces premiers clichés de l’hôtel Jolicœur, nous voyons bien que cet endroit a été, autrefois, il y a bien longtemps, un lieu plutôt luxueux. C’était sans doute du temps où il y avait, à proximité, là où se trouve aujourd’hui la Polyvalente Pierre-Dupuy, le Stade Delorimier, domicile des défunts Royaux de Montréal, équipe de baseball dans laquelle avait débuté le célèbre![]() Jackie Robinson dans les années 40, avant d’aller jouer pour les équipes américaines. Le Stade Delorimier attirait aussi bien les matchs de baseball que les réunions politiques. De 1928 à 1965, année où il fut démoli, il amena au quartier des sportifs, des politiciens et des partisans qui durent faire les grandes heures de l’hôtel Jolicœur. Situé à la sortie du pont Jacques-Cartier, à partir des années 30, il était le premier hôtel venant s’offrir aux touristes arrivés de l’extérieur de l’île. D’hôtel chic avec réservations et suites élégantes, l’hôtel Jolicœur n’était plus qu’une taverne parmi d’autres, avec des étages pour faire la passe lorsque j’habitais le quartier. Maintenant qu’il est en chantier, nous voyons les appartements réduits à leur plus simple expression.
Jackie Robinson dans les années 40, avant d’aller jouer pour les équipes américaines. Le Stade Delorimier attirait aussi bien les matchs de baseball que les réunions politiques. De 1928 à 1965, année où il fut démoli, il amena au quartier des sportifs, des politiciens et des partisans qui durent faire les grandes heures de l’hôtel Jolicœur. Situé à la sortie du pont Jacques-Cartier, à partir des années 30, il était le premier hôtel venant s’offrir aux touristes arrivés de l’extérieur de l’île. D’hôtel chic avec réservations et suites élégantes, l’hôtel Jolicœur n’était plus qu’une taverne parmi d’autres, avec des étages pour faire la passe lorsque j’habitais le quartier. Maintenant qu’il est en chantier, nous voyons les appartements réduits à leur plus simple expression.
Qu’un groupe d’artistes venant de la photographie et des arts graphiques, de comédiens, d’écrivains se soient promenés dans ce lieu pour y trouver une source d’inspiration majeure, pourquoi pas? Mais qu’y cherchaient-ils réellement sinon que d'éprouver cette sensation de stupeur devant l'horrible? Faire un livre «esthétique» centré sur un bordel d’un autre âge n’est pas usité. Je remarque que ce sont de jeunes gens, très souvent![]() issus de l’extérieur de Montréal. Sans doute ont-ils connu eux aussi, d’une façon ou d’une autre, des moments tragiques, ou encore des moments qui confinent à l’extase, voire au myste. Des individus, des lieux, des instants où la vie et la mort se confondent par une extrémité ou une autre. Mais, à première vue, ils semblent aborder l’hôtel Jolicœur davantage comme un bordel onirique qu’un lieu réel de souffrances misérabilistes de la petite pègre. Pour eux, il peut s'avérer bon de rappeler que le sublime n’a rien de la beauté, pas même de cette laideur esthétique dont Umberto Eco a fait un magnifique volume. Le philosophe Edmund Burke (1729-1797) a bien su distinguer le beau du sublime : «Relevant du beau, dit-il, les objets menus aux surfaces lisses, dont les lignes ne s’écartent qu’insensiblement de la ligne droite. Le beau ne peut pas être obscur, il est léger et délicat; il se fonde sur le plaisir». Décidément, comment peut-on penser faire du beau, littéraire ou artistique, avec les murs craquelés, le plâtre décollé, les planchers défoncés des vestiges de l’hôtel Jolicœur? Une poésie de l’érotisme de Fabien Loszach, telle qu'on peut la lire sur le site Web du livre ne peut qu'apparaître mièvre (ou niaise) :
issus de l’extérieur de Montréal. Sans doute ont-ils connu eux aussi, d’une façon ou d’une autre, des moments tragiques, ou encore des moments qui confinent à l’extase, voire au myste. Des individus, des lieux, des instants où la vie et la mort se confondent par une extrémité ou une autre. Mais, à première vue, ils semblent aborder l’hôtel Jolicœur davantage comme un bordel onirique qu’un lieu réel de souffrances misérabilistes de la petite pègre. Pour eux, il peut s'avérer bon de rappeler que le sublime n’a rien de la beauté, pas même de cette laideur esthétique dont Umberto Eco a fait un magnifique volume. Le philosophe Edmund Burke (1729-1797) a bien su distinguer le beau du sublime : «Relevant du beau, dit-il, les objets menus aux surfaces lisses, dont les lignes ne s’écartent qu’insensiblement de la ligne droite. Le beau ne peut pas être obscur, il est léger et délicat; il se fonde sur le plaisir». Décidément, comment peut-on penser faire du beau, littéraire ou artistique, avec les murs craquelés, le plâtre décollé, les planchers défoncés des vestiges de l’hôtel Jolicœur? Une poésie de l’érotisme de Fabien Loszach, telle qu'on peut la lire sur le site Web du livre ne peut qu'apparaître mièvre (ou niaise) :
 lieux de réfrigération éventrés, ses hangars recouverts de feuilles de métal qui absorbaient la chaleur du soleil en été et allumaient des incendies à partir des structures de bois imbibées d’huile, ses trottoirs crevassés et ses rues remplies de nids de poule dans lesquels on se tord les chevilles, accidents pour lesquels la municipalité se dégage de toutes responsabilités. Montréal reste, malgré tous ces efforts, une ville laide, à peine urbanisée dans le sens architectural. Usant périodiquement d'une thérapie au botox bitumineux, l'imaginaire urbain enduit de vieilles maisons ouvrières d'un mica qui les transforme en chaumières petite-bourgeoises pour bobos du Plateau Mont-Royal ou résidents de l’ancien Faubourg à m‘lasse, aujourd’hui centré sur le quartier gay.
lieux de réfrigération éventrés, ses hangars recouverts de feuilles de métal qui absorbaient la chaleur du soleil en été et allumaient des incendies à partir des structures de bois imbibées d’huile, ses trottoirs crevassés et ses rues remplies de nids de poule dans lesquels on se tord les chevilles, accidents pour lesquels la municipalité se dégage de toutes responsabilités. Montréal reste, malgré tous ces efforts, une ville laide, à peine urbanisée dans le sens architectural. Usant périodiquement d'une thérapie au botox bitumineux, l'imaginaire urbain enduit de vieilles maisons ouvrières d'un mica qui les transforme en chaumières petite-bourgeoises pour bobos du Plateau Mont-Royal ou résidents de l’ancien Faubourg à m‘lasse, aujourd’hui centré sur le quartier gay.À un pâté de maisons de chez moi, au coin des rues Rachel et Iberville, il y a un édifice converti depuis quelques années en condos. Il y a 20 ans, lorsque je suis venu résidé à l’endroit où je demeure présentement, c’était un bunker, un édifice dont les fenêtres, du sous-sol au dernier étage,
 étaient murées de ciment. Avec raison, car c’était un entrepôt où s’entassaient des dizaines de milliers de pneus usagés. Et avant ça, cet édifice n’était nulle autre que la manufacture de chaussures Lagrenade, où les felquistes, le 5 mai 1966, lors d'un conflit ouvrier, avaient fait sauter un colis piégé, tuant une secrétaire. C’est à la fois troublant et mystérieux chaque fois que je vois ce vieux bout de film en noir et blanc des actualités de l’époque qui nous montre la civière portant le cadavre de Mme Morin passant par la porte par où, aujourd’hui, défilent les «branchés» qui habitent l’endroit. La plupart d’entre eux, j’en suis sûr, ignorent le drame terrible qui s’est passé là, bien avant même leur conception! De la manufacture Lagrenade au bunker de tires, au condo de bobos c’est un demi-siècle d’évolution de l’histoire d’un bâtiment que nous détenons-là. Est-il plus «beau» aujourd’hui qu’à l’époque? Son style s’est adapté à chaque nouvelle fonction. Seulement, il est toujours aussi laid.
étaient murées de ciment. Avec raison, car c’était un entrepôt où s’entassaient des dizaines de milliers de pneus usagés. Et avant ça, cet édifice n’était nulle autre que la manufacture de chaussures Lagrenade, où les felquistes, le 5 mai 1966, lors d'un conflit ouvrier, avaient fait sauter un colis piégé, tuant une secrétaire. C’est à la fois troublant et mystérieux chaque fois que je vois ce vieux bout de film en noir et blanc des actualités de l’époque qui nous montre la civière portant le cadavre de Mme Morin passant par la porte par où, aujourd’hui, défilent les «branchés» qui habitent l’endroit. La plupart d’entre eux, j’en suis sûr, ignorent le drame terrible qui s’est passé là, bien avant même leur conception! De la manufacture Lagrenade au bunker de tires, au condo de bobos c’est un demi-siècle d’évolution de l’histoire d’un bâtiment que nous détenons-là. Est-il plus «beau» aujourd’hui qu’à l’époque? Son style s’est adapté à chaque nouvelle fonction. Seulement, il est toujours aussi laid.Voilà maintenant qu’un groupe d’artistes s’unit pour créer un album esthétique sur un édifice qui s’apprête également à être renippé en condos, au coin des rues Ontario et Papineau; l’ancien hôtel Jolicœur. Cet hôtel au joli cœur était en fait un
 bazar de corps humains. L’hôtel Jolicœur, en effet, était un hôtel de passe. Moi, qui ai habité quelques années au coin des rues Ontario et Des Érables, il m’arrivait de passer devant quotidiennement. C'était au temps où la rue Ontario était encore une rue peu recommandable, avec un vieil entrepôt reconverti en quincaillerie qui avait conservé sur son mur en briques extérieur une vieille publicité peinte de Quaker Oats du début du XXe siècle! Les «bineries» étaient minables. Les commerces délabrés. Les magasins d’antiquité, de vrais ramassis de marchés aux puces. On y trouvait un marchand de tabac célèbre, qui y réside toujours, et l’Association des Père Noël qui n’y est plus. Au milieu trônaient deux grandes églises aux dimensions de cathédrales et qui étendaient le
bazar de corps humains. L’hôtel Jolicœur, en effet, était un hôtel de passe. Moi, qui ai habité quelques années au coin des rues Ontario et Des Érables, il m’arrivait de passer devant quotidiennement. C'était au temps où la rue Ontario était encore une rue peu recommandable, avec un vieil entrepôt reconverti en quincaillerie qui avait conservé sur son mur en briques extérieur une vieille publicité peinte de Quaker Oats du début du XXe siècle! Les «bineries» étaient minables. Les commerces délabrés. Les magasins d’antiquité, de vrais ramassis de marchés aux puces. On y trouvait un marchand de tabac célèbre, qui y réside toujours, et l’Association des Père Noël qui n’y est plus. Au milieu trônaient deux grandes églises aux dimensions de cathédrales et qui étendaient le  pouvoir clérical sur cette masse d’habitants pauvres, esseulés ou dotés de familles nombreuses, des travailleurs ou ouvrières des manufactures du quartier. À partir des années 90, le quartier gay est venu s’établir sur la rue Sainte-Catherine. La prostitution féminine se trouva repoussée sur la rue Ontario. Comme les endroits sombres et les arrières-cours y sont nombreux, il y a de la place pour toutes les passes possibles. L’hôtel Jolicœur n’était pas le moins fréquenté de la place. Pendant qu’au rez-de-chaussée on buvait à profusion, les chambres aux étages étaient occupées par des prostituées en fin de carrière, alcooliques ou droguées, battues, violentées et même probablement tuées. De tout le quartier, il y avait là le cercle le plus profond de l’Enfer, où les damnées venaient y pousser leur dernier râle. Le temps de nettoyer les murs ou les planchers souillés, et une autre venait prendre la place de celle qui n’était plus.
pouvoir clérical sur cette masse d’habitants pauvres, esseulés ou dotés de familles nombreuses, des travailleurs ou ouvrières des manufactures du quartier. À partir des années 90, le quartier gay est venu s’établir sur la rue Sainte-Catherine. La prostitution féminine se trouva repoussée sur la rue Ontario. Comme les endroits sombres et les arrières-cours y sont nombreux, il y a de la place pour toutes les passes possibles. L’hôtel Jolicœur n’était pas le moins fréquenté de la place. Pendant qu’au rez-de-chaussée on buvait à profusion, les chambres aux étages étaient occupées par des prostituées en fin de carrière, alcooliques ou droguées, battues, violentées et même probablement tuées. De tout le quartier, il y avait là le cercle le plus profond de l’Enfer, où les damnées venaient y pousser leur dernier râle. Le temps de nettoyer les murs ou les planchers souillés, et une autre venait prendre la place de celle qui n’était plus.C’est une sensation beaucoup plus qu’un sentiment, et donc difficile à définir avec des mots. Je me souviens l’avoir ressenti une première (et une rare)
 fois en regardant, vers l’âge de 16 ans, la photo de la pièce, dans la cave de la Maison Ipatiev, où la famille du tsar Nicolas II avait été exécutée à coups de pistolets (1918). La porte fermée, les trous de balles dans les murs, les morceaux de boiseries fauchés par la mitraille, les débris de toutes sortes jonchant le plancher. Je me suis senti sur le coup envahi par une stupeur, une stupeur au sens étymologique du terme, comme un petit animal fasciné par un serpent. La Mort. La mort violente avait été là. Et Elle était encore visible sur le vieux cliché. Depuis, j’ai revu cette scène bien souvent et dans le compte-rendu de l’enquête Sokoloff, tous les clichés photométriques de la scène y sont. De sorte, que je ne ressens plus guère cette première sensation quand je regarde aujourd'hui la photographie tragique.
fois en regardant, vers l’âge de 16 ans, la photo de la pièce, dans la cave de la Maison Ipatiev, où la famille du tsar Nicolas II avait été exécutée à coups de pistolets (1918). La porte fermée, les trous de balles dans les murs, les morceaux de boiseries fauchés par la mitraille, les débris de toutes sortes jonchant le plancher. Je me suis senti sur le coup envahi par une stupeur, une stupeur au sens étymologique du terme, comme un petit animal fasciné par un serpent. La Mort. La mort violente avait été là. Et Elle était encore visible sur le vieux cliché. Depuis, j’ai revu cette scène bien souvent et dans le compte-rendu de l’enquête Sokoloff, tous les clichés photométriques de la scène y sont. De sorte, que je ne ressens plus guère cette première sensation quand je regarde aujourd'hui la photographie tragique. En Amérique, toutes les villes ont leurs quartiers sordides. New York, Chicago, Los Angeles ont leurs lieux maudits où ont été assassiné ou suicidé telle ou telle personne. Il m’arrive de recevoir, parmi mes «sources de trafic» sur mon blogue, des gens qui demandent à voir le 10050 Cielo Drive, la demeure Polanski, où fut jadis éventrée et tuée l’actrice Sharon Tate ainsi que quatre autres personnes. Là aussi, surtout sur les clichés en noir et blanc, nous percevons la même sensation de la Mort présente, même une fois les cadavres évacués.
En Amérique, toutes les villes ont leurs quartiers sordides. New York, Chicago, Los Angeles ont leurs lieux maudits où ont été assassiné ou suicidé telle ou telle personne. Il m’arrive de recevoir, parmi mes «sources de trafic» sur mon blogue, des gens qui demandent à voir le 10050 Cielo Drive, la demeure Polanski, où fut jadis éventrée et tuée l’actrice Sharon Tate ainsi que quatre autres personnes. Là aussi, surtout sur les clichés en noir et blanc, nous percevons la même sensation de la Mort présente, même une fois les cadavres évacués.Peut-être, effectivement, la technique du noir et blanc rend-t-elle ces scènes de crimes plus «efficaces» dans la perception sensorielle du spectateur. Les clichés en couleurs du 10050 Cielo Drive, avec les corps sanglants encore sur la moquette du tapis, ne me donnent pas la même sensation. L’horreur, le dégoût certainement, le pathos, mais pas la sensation de la présence inscrite de la Mort. Même
 chose lorsque je regarde des clichés couleurs du garde-manger de Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. Par contre, que dire des scènes en noir et blanc du film Being at home with Claude, de Jean Beaudin (1992), montrant la rencontre du prostitué avec un étudiant en littérature - dont il deviendra l’amant et finira par l’égorger au cours d’une scène de baise torride -, qui présente le «petit parc des Portugais», coin Saint-Laurent et Marie-Anne, pendant que se déroule le Festival de Jazz? Jamais, je crois, un cinéaste a réussi à rendre aussi bien compte par ces quelques séquences, les meilleures du film, de cette inquiétante étrangeté qui hante Montréal, la nuit, sous la moiteur de l'été.
chose lorsque je regarde des clichés couleurs du garde-manger de Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. Par contre, que dire des scènes en noir et blanc du film Being at home with Claude, de Jean Beaudin (1992), montrant la rencontre du prostitué avec un étudiant en littérature - dont il deviendra l’amant et finira par l’égorger au cours d’une scène de baise torride -, qui présente le «petit parc des Portugais», coin Saint-Laurent et Marie-Anne, pendant que se déroule le Festival de Jazz? Jamais, je crois, un cinéaste a réussi à rendre aussi bien compte par ces quelques séquences, les meilleures du film, de cette inquiétante étrangeté qui hante Montréal, la nuit, sous la moiteur de l'été.Les policiers qui, au printemps 2012, découvrirent le tronc mutilé de l'étudiant chinois emballé dans une valise à Côte-des-Neiges durent éprouver une stupeur semblable, et encore bien plus traumatisante. Mais ceci dit, ayant vu la vidéo de Luka Magnotta, je n’ai rien ressenti d’une pareille stupeur semblable à celle
 éprouvée devant la photo de la cave de la Maison Ipatiev. Pourquoi? Parce que la vidéo était en couleur me direz-vous? Non. Je ne le pense pas. Même en noir et blanc, ce film me fut resté long, ennuyeux, et sauf respect pour la victime, d'une banalité de l’horreur sordide et obscène. Même la Mort, semble-t-il, n’aime pas être mêlée à des exhibitionnismes de ce genre. Peut-être a-t-elle un certain respect d’elle-même qui fait que bien peu d’entre nous allons mourir à la manière d’un Jun Lin. C’est parce que cette sensation de stupeur qu’elle provoque en nous est difficile à traduire que, pour la saisir, les films et les séries d’horreur sont-ils obligés d’amplifier les scènes de torture morale et de meurtre. Détailler les corps dépecés, décapités, démembrés, écorchés. Ce sont-là des morts beaucoup plus fantasmatiques et littéraires que réelles. Ayant vécu de près la mort de ma mère, je dois reconnaître aujourd'hui, que tout se fait paisiblement, grâce sans doute aux médicaments qui assurent la transition de la souffrance vers «l'état cadavérique», mais la mort de la personne n’a plus rien d’horrifiant en soi. Ce n’est que lorsque la peau commence à se déshydrater et à coller aux muscles et aux os que toute la laideur du cadavre apparaît et
éprouvée devant la photo de la cave de la Maison Ipatiev. Pourquoi? Parce que la vidéo était en couleur me direz-vous? Non. Je ne le pense pas. Même en noir et blanc, ce film me fut resté long, ennuyeux, et sauf respect pour la victime, d'une banalité de l’horreur sordide et obscène. Même la Mort, semble-t-il, n’aime pas être mêlée à des exhibitionnismes de ce genre. Peut-être a-t-elle un certain respect d’elle-même qui fait que bien peu d’entre nous allons mourir à la manière d’un Jun Lin. C’est parce que cette sensation de stupeur qu’elle provoque en nous est difficile à traduire que, pour la saisir, les films et les séries d’horreur sont-ils obligés d’amplifier les scènes de torture morale et de meurtre. Détailler les corps dépecés, décapités, démembrés, écorchés. Ce sont-là des morts beaucoup plus fantasmatiques et littéraires que réelles. Ayant vécu de près la mort de ma mère, je dois reconnaître aujourd'hui, que tout se fait paisiblement, grâce sans doute aux médicaments qui assurent la transition de la souffrance vers «l'état cadavérique», mais la mort de la personne n’a plus rien d’horrifiant en soi. Ce n’est que lorsque la peau commence à se déshydrater et à coller aux muscles et aux os que toute la laideur du cadavre apparaît et  qu’il vaut mieux partir afin de ne pas laisser cette image devenir la dernière de la personne aimée. Mais même, je me répète, le moment de sa mort n'a pas suscité en moi une sensation pareille. La Mort qui se laisse voir a besoin d’une atmosphère qui lui est propice. Les lieux où ont été commis des crimes inouïs - nous pensons à Auschwitz plus particulièrement -, laissent voir la grimace de la Mort, peut-être parce que nous savons que ces morts n’ont pas été «naturelles». Que ces morts ont été le fruit de la méchanceté humaine, de la psychopathologie de grands criminels. Mais la banalité de l’horreur ne cède en rien à l'inquiétante étrangeté des lieux. L’hôtel Jolicœur, pour ne pas être le motel Bates, n’en était pas moins un lieu où se sont commis les transactions de corps entre des clients, violents ou honteux, et des prostituées droguées et moralement suicidées.
qu’il vaut mieux partir afin de ne pas laisser cette image devenir la dernière de la personne aimée. Mais même, je me répète, le moment de sa mort n'a pas suscité en moi une sensation pareille. La Mort qui se laisse voir a besoin d’une atmosphère qui lui est propice. Les lieux où ont été commis des crimes inouïs - nous pensons à Auschwitz plus particulièrement -, laissent voir la grimace de la Mort, peut-être parce que nous savons que ces morts n’ont pas été «naturelles». Que ces morts ont été le fruit de la méchanceté humaine, de la psychopathologie de grands criminels. Mais la banalité de l’horreur ne cède en rien à l'inquiétante étrangeté des lieux. L’hôtel Jolicœur, pour ne pas être le motel Bates, n’en était pas moins un lieu où se sont commis les transactions de corps entre des clients, violents ou honteux, et des prostituées droguées et moralement suicidées.Lorsque nous regardons ces premiers clichés de l’hôtel Jolicœur, nous voyons bien que cet endroit a été, autrefois, il y a bien longtemps, un lieu plutôt luxueux. C’était sans doute du temps où il y avait, à proximité, là où se trouve aujourd’hui la Polyvalente Pierre-Dupuy, le Stade Delorimier, domicile des défunts Royaux de Montréal, équipe de baseball dans laquelle avait débuté le célèbre
 Jackie Robinson dans les années 40, avant d’aller jouer pour les équipes américaines. Le Stade Delorimier attirait aussi bien les matchs de baseball que les réunions politiques. De 1928 à 1965, année où il fut démoli, il amena au quartier des sportifs, des politiciens et des partisans qui durent faire les grandes heures de l’hôtel Jolicœur. Situé à la sortie du pont Jacques-Cartier, à partir des années 30, il était le premier hôtel venant s’offrir aux touristes arrivés de l’extérieur de l’île. D’hôtel chic avec réservations et suites élégantes, l’hôtel Jolicœur n’était plus qu’une taverne parmi d’autres, avec des étages pour faire la passe lorsque j’habitais le quartier. Maintenant qu’il est en chantier, nous voyons les appartements réduits à leur plus simple expression.
Jackie Robinson dans les années 40, avant d’aller jouer pour les équipes américaines. Le Stade Delorimier attirait aussi bien les matchs de baseball que les réunions politiques. De 1928 à 1965, année où il fut démoli, il amena au quartier des sportifs, des politiciens et des partisans qui durent faire les grandes heures de l’hôtel Jolicœur. Situé à la sortie du pont Jacques-Cartier, à partir des années 30, il était le premier hôtel venant s’offrir aux touristes arrivés de l’extérieur de l’île. D’hôtel chic avec réservations et suites élégantes, l’hôtel Jolicœur n’était plus qu’une taverne parmi d’autres, avec des étages pour faire la passe lorsque j’habitais le quartier. Maintenant qu’il est en chantier, nous voyons les appartements réduits à leur plus simple expression.Qu’un groupe d’artistes venant de la photographie et des arts graphiques, de comédiens, d’écrivains se soient promenés dans ce lieu pour y trouver une source d’inspiration majeure, pourquoi pas? Mais qu’y cherchaient-ils réellement sinon que d'éprouver cette sensation de stupeur devant l'horrible? Faire un livre «esthétique» centré sur un bordel d’un autre âge n’est pas usité. Je remarque que ce sont de jeunes gens, très souvent
 issus de l’extérieur de Montréal. Sans doute ont-ils connu eux aussi, d’une façon ou d’une autre, des moments tragiques, ou encore des moments qui confinent à l’extase, voire au myste. Des individus, des lieux, des instants où la vie et la mort se confondent par une extrémité ou une autre. Mais, à première vue, ils semblent aborder l’hôtel Jolicœur davantage comme un bordel onirique qu’un lieu réel de souffrances misérabilistes de la petite pègre. Pour eux, il peut s'avérer bon de rappeler que le sublime n’a rien de la beauté, pas même de cette laideur esthétique dont Umberto Eco a fait un magnifique volume. Le philosophe Edmund Burke (1729-1797) a bien su distinguer le beau du sublime : «Relevant du beau, dit-il, les objets menus aux surfaces lisses, dont les lignes ne s’écartent qu’insensiblement de la ligne droite. Le beau ne peut pas être obscur, il est léger et délicat; il se fonde sur le plaisir». Décidément, comment peut-on penser faire du beau, littéraire ou artistique, avec les murs craquelés, le plâtre décollé, les planchers défoncés des vestiges de l’hôtel Jolicœur? Une poésie de l’érotisme de Fabien Loszach, telle qu'on peut la lire sur le site Web du livre ne peut qu'apparaître mièvre (ou niaise) :
issus de l’extérieur de Montréal. Sans doute ont-ils connu eux aussi, d’une façon ou d’une autre, des moments tragiques, ou encore des moments qui confinent à l’extase, voire au myste. Des individus, des lieux, des instants où la vie et la mort se confondent par une extrémité ou une autre. Mais, à première vue, ils semblent aborder l’hôtel Jolicœur davantage comme un bordel onirique qu’un lieu réel de souffrances misérabilistes de la petite pègre. Pour eux, il peut s'avérer bon de rappeler que le sublime n’a rien de la beauté, pas même de cette laideur esthétique dont Umberto Eco a fait un magnifique volume. Le philosophe Edmund Burke (1729-1797) a bien su distinguer le beau du sublime : «Relevant du beau, dit-il, les objets menus aux surfaces lisses, dont les lignes ne s’écartent qu’insensiblement de la ligne droite. Le beau ne peut pas être obscur, il est léger et délicat; il se fonde sur le plaisir». Décidément, comment peut-on penser faire du beau, littéraire ou artistique, avec les murs craquelés, le plâtre décollé, les planchers défoncés des vestiges de l’hôtel Jolicœur? Une poésie de l’érotisme de Fabien Loszach, telle qu'on peut la lire sur le site Web du livre ne peut qu'apparaître mièvre (ou niaise) :Je regardais la plus belle
avec les yeux du gars
qui s’imagine plein de choses,
mais qui a bien trop peur
de tomber dans l’abîme
du péché s’il les réalisaient [sic!]
Blonde, 45-50 ans, des fesses
et des jambes de danseuse.
Elle [sic!] doivent être faites en titane
avec tout ce qu’elles ont vécu.
Il est vrai que les péripatéticiennes
marchent beaucoup,
leur gym c’est le bitume.
Mais si l’on poursuit la définition de Burke : «Relèvent du sublime, au contraire, les objets dont les dimensions sont vastes et rappellent la notion d’infini. Leurs surfaces doivent être rugueuses, ![]() irrégulières et donner l’impression de négligé. Leurs lignes sont souvent toutes droites ou, si elles dévient, le font brusquement et totalement. Le sublime ne se conçoit qu’entouré de pénombre, il est toujours compact et massif et se fonde sur la douleur ou la crainte de la douleur. Tout ce qui évoque un danger quelconque, c’est-à-dire tout ce qui est terrifiant, est donc générateur de sublime» (Cité in Maurice Lévy. Le roman “gothique” anglais 1764-1824, Paris, Albin Michel, Col. Bibliothèque de l’Évolution de l’humanité, # 11, 1995, pp. 70-71). Des quelques photos que les concepteurs du livre nous offrent sur le Web, c’est la photographie du lieu # 4, celle du lavabo qui est placée en tête de ce texte, qui peut faire surgir en moi la sensation déjà éprouvée de stupeur, mais aussi, comme Burke la qualifie, un sentiment de sublime.
irrégulières et donner l’impression de négligé. Leurs lignes sont souvent toutes droites ou, si elles dévient, le font brusquement et totalement. Le sublime ne se conçoit qu’entouré de pénombre, il est toujours compact et massif et se fonde sur la douleur ou la crainte de la douleur. Tout ce qui évoque un danger quelconque, c’est-à-dire tout ce qui est terrifiant, est donc générateur de sublime» (Cité in Maurice Lévy. Le roman “gothique” anglais 1764-1824, Paris, Albin Michel, Col. Bibliothèque de l’Évolution de l’humanité, # 11, 1995, pp. 70-71). Des quelques photos que les concepteurs du livre nous offrent sur le Web, c’est la photographie du lieu # 4, celle du lavabo qui est placée en tête de ce texte, qui peut faire surgir en moi la sensation déjà éprouvée de stupeur, mais aussi, comme Burke la qualifie, un sentiment de sublime.
Car c'est à la définition que Burke donne du sublime que ce lavabo renvoie. Il domine bien tout le plan de l’image avec sa vidange obstruée par les![]() détritus accumulés et la fourchette levée qui apparaît comme une menace dérisoire devant un accès bloqué à l’infini. Sa surface est rugueuse, irrégulière parce que souillée. Des générations d’accumulations de cheveux de femmes, de sang, de souillures, compactées, sédimentées les unes sur les autres, autant de témoignages des épreuves endurées par les prostituées et les forts sentiments de déchéance des clients qui se sont suivis dans cette antichambre de la Mort. La vidange de ce lavabo menacée par une fourchette renversée sur le dos renvoie également à une sexualité forclose. Ici, symboliquement à un vagin qui, même sollicité, ne sécrètera jamais plus de cyprine, par où ne passent déjà plus les menstrues depuis longtemps. Des lèvres séchées, noircies à jamais. Un clitoris disparu, enfoui dans les sédiments de craie, de plâtres, de savon, de pâtes dentifrices, de moisissures. Ce lavabo est un puits sans fond de douleurs et de craintes, comme l’écrit Burke. Pour moi qui regarde, je ressens la stupeur qu’étant adolescent, j’avais ressentie à regarder les murs mitraillés de la salle de la Maison Ipatiev. C’est terrifiant. C’est sublime.
détritus accumulés et la fourchette levée qui apparaît comme une menace dérisoire devant un accès bloqué à l’infini. Sa surface est rugueuse, irrégulière parce que souillée. Des générations d’accumulations de cheveux de femmes, de sang, de souillures, compactées, sédimentées les unes sur les autres, autant de témoignages des épreuves endurées par les prostituées et les forts sentiments de déchéance des clients qui se sont suivis dans cette antichambre de la Mort. La vidange de ce lavabo menacée par une fourchette renversée sur le dos renvoie également à une sexualité forclose. Ici, symboliquement à un vagin qui, même sollicité, ne sécrètera jamais plus de cyprine, par où ne passent déjà plus les menstrues depuis longtemps. Des lèvres séchées, noircies à jamais. Un clitoris disparu, enfoui dans les sédiments de craie, de plâtres, de savon, de pâtes dentifrices, de moisissures. Ce lavabo est un puits sans fond de douleurs et de craintes, comme l’écrit Burke. Pour moi qui regarde, je ressens la stupeur qu’étant adolescent, j’avais ressentie à regarder les murs mitraillés de la salle de la Maison Ipatiev. C’est terrifiant. C’est sublime.
Seules les prostituées souffrantes ayant «travaillé» ou traînées leurs misères à l’hôtel Jolicœur peuvent donner un sens réel à cet endroit, par tous ces drames qu’il n’est pas besoin![]() d’imaginer pour savoir qu’ils ont bien existé. Affronter le sublime est terrifiant par définition comme l'enseigne la pensée esthétique de Burke, aussi, est-il beaucoup plus facile de glisser sur le sujet, avec un poème nubile, et se retrouver dans le néant plutôt que de parvenir, par la versification ou la prose, à dominer la terreur et accéder au sublime. Je suis pour la conservation des bâtiments historiques, même des bordels, comme ceux de la rue De Bullion. Ils font partie du non-dit de l’histoire de la bourgeoisie montréalaise comme des milieux ouvrier et interlope. Le problème avec ce projet de création collective, c’est que l’hôtel Joliecœur n’aurait jamais existé, n’aurait jamais été ce qu’il a été durant tant de générations, que ces photographies, ces arts graphiques, ces poèmes se seraient exprimés de toutes façons, gravitant autour d’une autre place suintant le sordide⌛
d’imaginer pour savoir qu’ils ont bien existé. Affronter le sublime est terrifiant par définition comme l'enseigne la pensée esthétique de Burke, aussi, est-il beaucoup plus facile de glisser sur le sujet, avec un poème nubile, et se retrouver dans le néant plutôt que de parvenir, par la versification ou la prose, à dominer la terreur et accéder au sublime. Je suis pour la conservation des bâtiments historiques, même des bordels, comme ceux de la rue De Bullion. Ils font partie du non-dit de l’histoire de la bourgeoisie montréalaise comme des milieux ouvrier et interlope. Le problème avec ce projet de création collective, c’est que l’hôtel Joliecœur n’aurait jamais existé, n’aurait jamais été ce qu’il a été durant tant de générations, que ces photographies, ces arts graphiques, ces poèmes se seraient exprimés de toutes façons, gravitant autour d’une autre place suintant le sordide⌛
 irrégulières et donner l’impression de négligé. Leurs lignes sont souvent toutes droites ou, si elles dévient, le font brusquement et totalement. Le sublime ne se conçoit qu’entouré de pénombre, il est toujours compact et massif et se fonde sur la douleur ou la crainte de la douleur. Tout ce qui évoque un danger quelconque, c’est-à-dire tout ce qui est terrifiant, est donc générateur de sublime» (Cité in Maurice Lévy. Le roman “gothique” anglais 1764-1824, Paris, Albin Michel, Col. Bibliothèque de l’Évolution de l’humanité, # 11, 1995, pp. 70-71). Des quelques photos que les concepteurs du livre nous offrent sur le Web, c’est la photographie du lieu # 4, celle du lavabo qui est placée en tête de ce texte, qui peut faire surgir en moi la sensation déjà éprouvée de stupeur, mais aussi, comme Burke la qualifie, un sentiment de sublime.
irrégulières et donner l’impression de négligé. Leurs lignes sont souvent toutes droites ou, si elles dévient, le font brusquement et totalement. Le sublime ne se conçoit qu’entouré de pénombre, il est toujours compact et massif et se fonde sur la douleur ou la crainte de la douleur. Tout ce qui évoque un danger quelconque, c’est-à-dire tout ce qui est terrifiant, est donc générateur de sublime» (Cité in Maurice Lévy. Le roman “gothique” anglais 1764-1824, Paris, Albin Michel, Col. Bibliothèque de l’Évolution de l’humanité, # 11, 1995, pp. 70-71). Des quelques photos que les concepteurs du livre nous offrent sur le Web, c’est la photographie du lieu # 4, celle du lavabo qui est placée en tête de ce texte, qui peut faire surgir en moi la sensation déjà éprouvée de stupeur, mais aussi, comme Burke la qualifie, un sentiment de sublime.Car c'est à la définition que Burke donne du sublime que ce lavabo renvoie. Il domine bien tout le plan de l’image avec sa vidange obstruée par les
 détritus accumulés et la fourchette levée qui apparaît comme une menace dérisoire devant un accès bloqué à l’infini. Sa surface est rugueuse, irrégulière parce que souillée. Des générations d’accumulations de cheveux de femmes, de sang, de souillures, compactées, sédimentées les unes sur les autres, autant de témoignages des épreuves endurées par les prostituées et les forts sentiments de déchéance des clients qui se sont suivis dans cette antichambre de la Mort. La vidange de ce lavabo menacée par une fourchette renversée sur le dos renvoie également à une sexualité forclose. Ici, symboliquement à un vagin qui, même sollicité, ne sécrètera jamais plus de cyprine, par où ne passent déjà plus les menstrues depuis longtemps. Des lèvres séchées, noircies à jamais. Un clitoris disparu, enfoui dans les sédiments de craie, de plâtres, de savon, de pâtes dentifrices, de moisissures. Ce lavabo est un puits sans fond de douleurs et de craintes, comme l’écrit Burke. Pour moi qui regarde, je ressens la stupeur qu’étant adolescent, j’avais ressentie à regarder les murs mitraillés de la salle de la Maison Ipatiev. C’est terrifiant. C’est sublime.
détritus accumulés et la fourchette levée qui apparaît comme une menace dérisoire devant un accès bloqué à l’infini. Sa surface est rugueuse, irrégulière parce que souillée. Des générations d’accumulations de cheveux de femmes, de sang, de souillures, compactées, sédimentées les unes sur les autres, autant de témoignages des épreuves endurées par les prostituées et les forts sentiments de déchéance des clients qui se sont suivis dans cette antichambre de la Mort. La vidange de ce lavabo menacée par une fourchette renversée sur le dos renvoie également à une sexualité forclose. Ici, symboliquement à un vagin qui, même sollicité, ne sécrètera jamais plus de cyprine, par où ne passent déjà plus les menstrues depuis longtemps. Des lèvres séchées, noircies à jamais. Un clitoris disparu, enfoui dans les sédiments de craie, de plâtres, de savon, de pâtes dentifrices, de moisissures. Ce lavabo est un puits sans fond de douleurs et de craintes, comme l’écrit Burke. Pour moi qui regarde, je ressens la stupeur qu’étant adolescent, j’avais ressentie à regarder les murs mitraillés de la salle de la Maison Ipatiev. C’est terrifiant. C’est sublime.Seules les prostituées souffrantes ayant «travaillé» ou traînées leurs misères à l’hôtel Jolicœur peuvent donner un sens réel à cet endroit, par tous ces drames qu’il n’est pas besoin
 d’imaginer pour savoir qu’ils ont bien existé. Affronter le sublime est terrifiant par définition comme l'enseigne la pensée esthétique de Burke, aussi, est-il beaucoup plus facile de glisser sur le sujet, avec un poème nubile, et se retrouver dans le néant plutôt que de parvenir, par la versification ou la prose, à dominer la terreur et accéder au sublime. Je suis pour la conservation des bâtiments historiques, même des bordels, comme ceux de la rue De Bullion. Ils font partie du non-dit de l’histoire de la bourgeoisie montréalaise comme des milieux ouvrier et interlope. Le problème avec ce projet de création collective, c’est que l’hôtel Joliecœur n’aurait jamais existé, n’aurait jamais été ce qu’il a été durant tant de générations, que ces photographies, ces arts graphiques, ces poèmes se seraient exprimés de toutes façons, gravitant autour d’une autre place suintant le sordide⌛
d’imaginer pour savoir qu’ils ont bien existé. Affronter le sublime est terrifiant par définition comme l'enseigne la pensée esthétique de Burke, aussi, est-il beaucoup plus facile de glisser sur le sujet, avec un poème nubile, et se retrouver dans le néant plutôt que de parvenir, par la versification ou la prose, à dominer la terreur et accéder au sublime. Je suis pour la conservation des bâtiments historiques, même des bordels, comme ceux de la rue De Bullion. Ils font partie du non-dit de l’histoire de la bourgeoisie montréalaise comme des milieux ouvrier et interlope. Le problème avec ce projet de création collective, c’est que l’hôtel Joliecœur n’aurait jamais existé, n’aurait jamais été ce qu’il a été durant tant de générations, que ces photographies, ces arts graphiques, ces poèmes se seraient exprimés de toutes façons, gravitant autour d’une autre place suintant le sordide⌛Montréal
18 mars 2013
18 mars 2013